
Ces gouttes d’eau qui font un océan

La Suisse participe financièrement à un projet d'approvisionnement d'eau en Crimée. Et, du même coup, à la cohabitation pacifique entre les ethnies.
Car en œuvrant au coude à coude pour la construction d’un système de distribution de l’eau potable, Russes et Tartares ont appris à mieux se connaître…
Chaque jour Osman, un jeune Tartare, doit aller tirer l’eau au puits. Une tâche fatigante qui l’empêche d’aller à l’école. Les Russes qui vivent de l’autre côté de la route le regardent avec mépris, ce qui ne lui facilite pas les choses. Lorsqu’il lève les yeux, son regard se perd dans la steppe aride, qui va jusqu’à l’horizon. Il n’a qu’un rêve: quitter cet endroit.
Cela, c’était il y a quinze ans, lorsque la rare eau disponible était celle qui provenait des entrailles de la terre.
«Grâce à l’aide de la Suisse notamment, notre village bénéficie aujourd’hui de l’eau potable, et nos conditions de vie sont bien meilleures», constate Sabri Ramazanov, membre de la communauté de Seyastyanovka, petite localité de la péninsule de Crimée, en Ukraine.
Améliorer la cohabitation entre ethnies
Au sommet de la colline qui surplombe ce bourg de 400 habitants, Sabri Ramazanov nous montre deux citernes d’une capacité de 100 m3 d’eau potable. Elles ont été installées dans le cadre de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIDP), promu par l’ONU.
«Nous finançons ce programme depuis 1996 par une contribution de quelque 500’000 francs par année», explique Ludmilla Nestrylav, responsable nationale du Bureau suisse de la coopération en Ukraine. Elle ajoute que le but du CIDP n’est pas seulement de garantir l’accès à l’eau, mais aussi d’améliorer la cohabitation entre les ethnies.
Car le village de Sevastyanovka est en grande partie habité par des Tartares de Crimée, d’origine turque et de confession musulmane. Par le passé, leur présence a suscité méfiance et hostilité parmi les résidants russes.
Un retour difficile
Déportés en masse par Staline après la Seconde guerre mondiale (parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir collaboré avec les nazis – mais plus vraisemblablement à cause de leur origine), les Tartares de Crimée ont été contraints à l’exil pendant près d’un demi-siècle.
Plusieurs centaines de milliers de personnes, appartenant à plusieurs ethnies minoritaires, ont dû se recréer une existence dans les territoires peu hospitaliers de la Sibérie et de l’Asie centrale, en particulier en Ouzbékistan.
A la fin des années 1980, le vent de la «glasnost» (la transparence prônée par l’ex-président Gorbatchev) a soufflé jusque sur leurs têtes, et 260’000 déportés ont pu rentrer chez eux. Leur retour n’a cependant pas été facile.
«A notre arrivée, nous avons dû tout reconstruire par nos propres moyens. L’Etat ne nous a rien donné. Tout était à refaire, les routes, les maisons, le réseau électrique et il n’y avait pas d’eau potable», se souvient Ayse Kudosova, députée du Conseil villageois.
De l’eau pour empêcher le conflit
Les Tartares n’ont pas seulement été confrontés à l’inefficacité et au désintérêt des autorités, mais ils ont aussi dû subir la malveillance des familles russes de la région. Conditionnés par des années et des années de récits sur la «cruauté des barbares musulmans», les habitants locaux ont mal accueilli les nouveaux venus. Discriminations et agressions n’ont pas manqué.
«La situation était effectivement délicate, explique Monsur Huetov, responsable national du CIDP, et nous risquions un conflit entre ethnies.»
La détermination des Tartares de Crimée pour se reconstruire une vie digne, malgré les obstacles, a heureusement pris le dessus. Ils représentent aujourd’hui 12% de la population de la péninsule.
A Seyastyanovka, en constituant un conseil communautaire, les Tartares ont jeté les bases d’une cohabitation pacifique. Et, parmi les projets qu’ils ont élaborés, le système d’approvisionnement en eau potable pour tout le village a également servi de terrain d’entente entre les deux groupes.
De grandes choses avec peu
Le financement du projet, assuré par le CIDP et la Confédération suisse, a donc permis aux Russes et aux Tartares d’œuvrer coude à coude à la réalisation d’un premier système hydrique efficace dans la région.
«Nous devions gérer ensemble l’infrastructure» explique Monsur Huetov. «Le climat s’est donc détendu et les relations sociales se sont améliorées.» Le responsable national du CIDP ajoute que l’efficacité de l’installation a également permis d’approvisionner le village voisin de Samohvalovo.
La communauté a participé activement à tout le processus, depuis la pose des conduites jusqu’à l’établissement des prix et la manutention. Une tâche qui a responsabilisé tous les habitants du bourg.
Par ailleurs, la contribution versée par les familles qui bénéficient du système de distribution de l’eau, soit 50 centimes par mois, permet au village de disposer d’un fond propre. Un petit capital capable de résoudre bien des problèmes: «L’eau coule goutte à goutte, mais chaque goutte peut former un océan», déclare Kamysheva Takize, députée du village, la tête recouverte d’un voile blanc.
Le rêve d’Osman
Lorsqu’on parcourt les rues du village, on remarque effectivement que l’eau a fait des miracles: les jardins arides d’antan sont devenus des potagers verdoyants et des vergers colorés.
Aujourd’hui le rêve d’Osman qui, entre-temps, a émigré à Simferopol, le chef-lieu de la péninsule, a basculé. Avec sa famille, il espère un jour ou l’autre rentrer dans son village, où la qualité de vie est désormais meilleure qu’en ville.
swissinfo, Luigi Jorio à Sevastyanovka, Crimée
(Traduction et adaptation de l’italien: Gemma d’Urso)
Sur une superficie de 26’000 km2, la République autonome de Crimée compte environ deux millions de personnes appartenant à 125 ethnies différentes.
Les trois groupes principaux sont les Russes (58%), les Ukrainiens (24%) et les Tartares (12%).
Depuis 1989, 260’000 personnes déportées par Staline au lendemain de la 2ème guerre mondiale
sont rentrées en Crimée. Il s’agissait pour la plupart de Tartares.
260’000 autres personnes environ se trouvent encore dans les territoires d’Asie centrale.
Les Tartares de Crimée vivent surtout de l’agriculture.
A l’époque des déportations ordonnées par Staline, ils ont dû vivre en exil dans les zones urbaines d’Asie centrale.
Durant cet exil forcé, les terres qui leur appartenaient en Crimée (en particulier sur les rives de la Mer noire) ont été illégalement occupées par des familles d’origine russe.
A leur retour dans leur patrie, les Tartares ont été placés par l’Etat dans des zones arides où ils n’avaient accès à aucun bien élémentaire comme l’eau, l’électricité ou le gaz.

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative























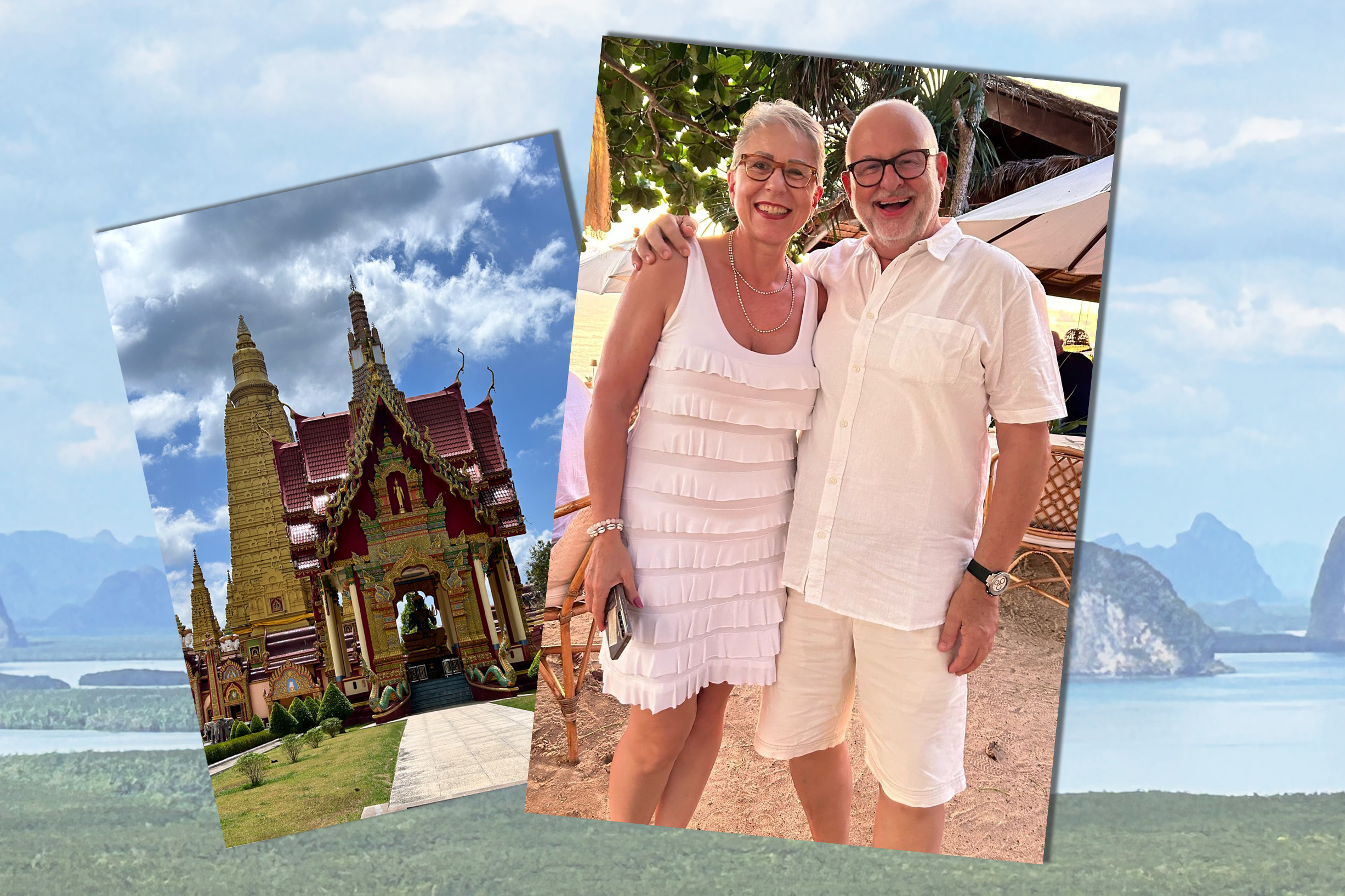







Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.