Le chercheur bâlois dont les travaux ont révolutionné la longévité
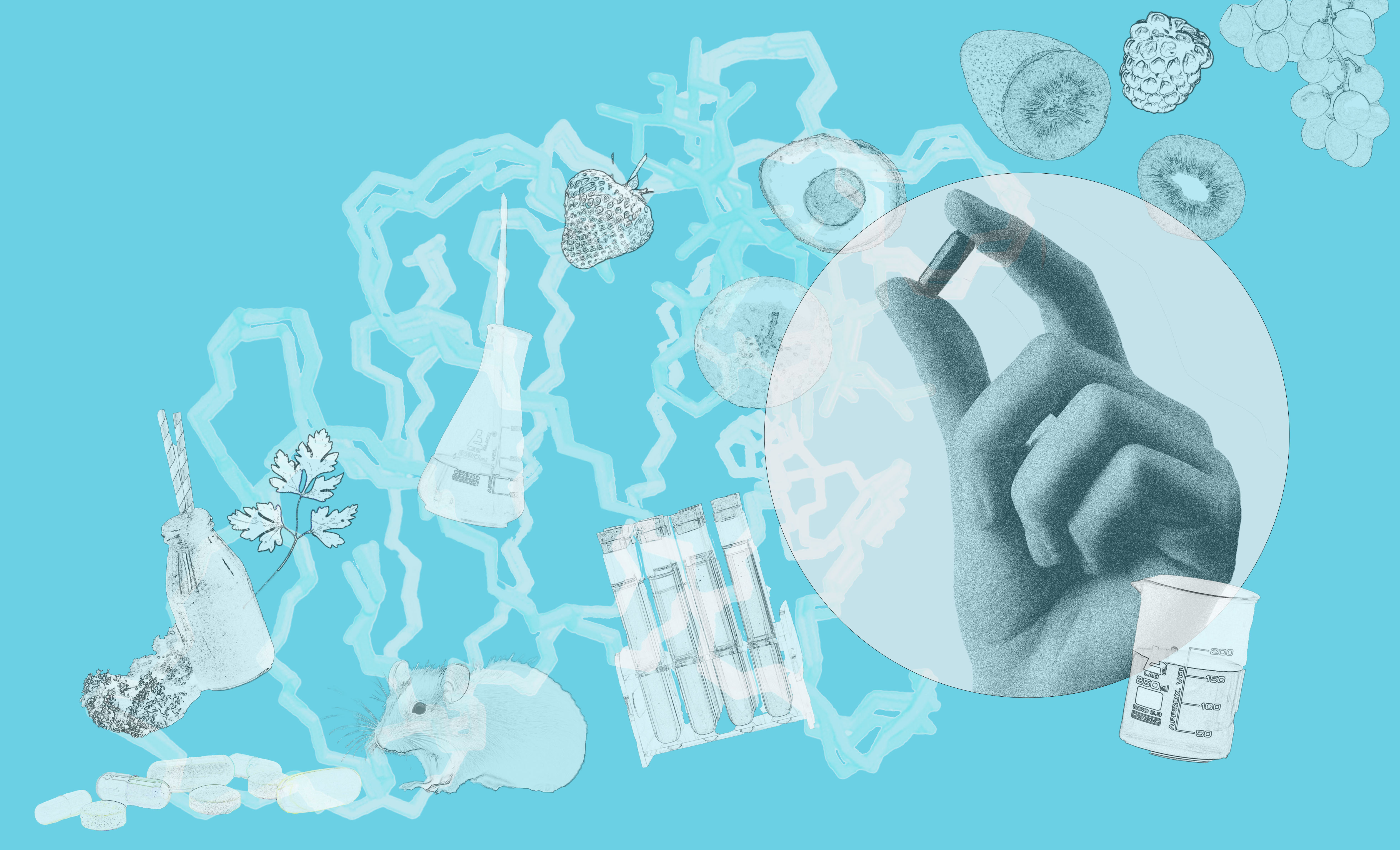
Biologiste moléculaire à l’Université de Bâle, Michael Hall a fait il y a plus de trente ans une découverte essentielle, celle du gène TOR, utile pour développer des remèdes contre le cancer. Ses travaux servent de référence à l’un des secteurs qui progresse le plus en santé et qui peut être lucratif, la longévité.
Michael Hall est pourtant quasiment un inconnu sur le devant de la scène de la longévité, thème qui fait les choux gras des médias sociaux. Il n’a en effet jamais publié de livre sur les causes du vieillissement ni tourné de films sur les secrets des centenaires. Il n’écoule pas non plus de compléments alimentaires ni ne loue lui-même les mérites de l’oxygène hyperbare ou de la thérapie par la lumière rouge, traitements utilisés dans les cliniques dédiées à la longévité.
Pour ce biologiste de 71 ans à la voix douce et qui évoque l’acteur américain Robert De Niro, le secret se résume «à de l’exercice, une alimentation saine, une vie sociale et si possible de bons gènes», a-t-il dépeint à swissinfo.ch.
L’absence de son nom dans la vague d’enthousiasme qui règne aujourd’hui autour de la longévité est à peine croyable. En effet, ses recherches ont transformé la compréhension du vieillissement. Et potentiellement la façon de le ralentir.
C’est au début des années 1990 que Michael Hall a fait la découverte d’un gène agissant chez les levures comme un disjoncteur dans la cellule de croissance et le métabolisme en réponse aux nutriments alentour. Il l’a baptisé Target of Rapamycin (cible de la rapamycine), abrégé en TOR, en référence à la bactérie rapamycine découverte dans les années 1960-70 et devenue par la suite un médicament immunosuppresseur utilisé souvent lors des greffes d’organes. Lorsque ce gène a été découvert chez les mammifèresLien externe, il l’a nommé mTOR.
Celui-ci impacte les processus cellulaires survenant avec l’âge. Prendre un médicament comme la rapamycine l’inhibe et active l’autophagie, soit un processus propre à la cellule pour éliminer en son sein les vieux tissus endommagés et les protéines accumulées à mesure que nous vieillissons.
Des études successives ont démontré que la rapamycine prolongeait la durée de vie de nombreuses espèces animales. Une communauté croissante d’adeptes de la longévité, à l’instar du célèbre physicien américain Peter AttiaLien externe, expérimente actuellement la rapamycine comme médicament pour contrer l’âge sur la base des découvertes de Michael Hall voici plus de trente ans.
Malgré sa contribution, ce dernier ne se considère pourtant pas comme un expert en vieillissement. Ses recherches ont surtout été axées sur la science fondamentale qui se cache derrière TOR et la façon dont celle-ci pourrait être utilisée contre le cancer. Il a reçu depuis de nombreux prix pour ses travaux. Ce n’est qu’en 2024 qu’il a été finalement salué pour sa part dans ce domaine.
En novembre dernier, il a reçu le prix Balzan qui honore chaque année quatre personnalités pour leurs réalisations dans les arts, les humanités et les sciences. Michael Hall a été récompensé pour «ses contributions révolutionnaires» dans la compréhension des mécanismes biologiques liés au vieillissement.
Premier contact avec la longévité
Toutefois, c’est bien avant de devenir scientifique qu’il s’était penché sur la question. Un de ses oncles, fortuné et excentrique, avait eu l’ambition de vivre jusqu’à cent ans. Celui-ci avait alors planifié une expédition pour sonder et examiner physiquement dans le monde «des centenaires vigoureux», comme il les désignait. Un autre oncle, médecin, l’avait suivi avec le chef de service de médecine du Massachusetts General Hospital, Alexander Leaf, ami des Hall.
«J’avais demandé en plaisantant s’ils avaient besoin de quelqu’un pour porter leurs valises. Mon oncle m’avait dit bien sûr», se rappelle-t-il. Michael Hall achevait à ce moment-là ses études de zoologie à l’Université de Caroline du Nord. «C’était dans les années 1970 et personne ne parlait du vieillissement.»
Mais leur mission n’avait pas vraiment été couronnée de succès. «Nous n’avons pas trouvé beaucoup de centenaires vigoureux», nous confie-t-il. En 2013, une nécrologieLien externe parue dans le New York Times après le décès d’Alexander Leaf avait obscurci ce genre d’expéditions parrainées alors par la National Geographic Society. Il s’était avéré que des personnes avaient en effet menti sur leur âge.

Si ce voyage n’avait pas entraîné de découvertes majeures, il l’avait marqué cependant. «Il m’avait amené à m’intéresser au vieillissement comme activité scientifique», explique-t-il. Il a continué de suivre cette spécialité à distance après son doctorat en biologie moléculaire à l’Université d’Harvard fin 1970.
Il se souvient également que «beaucoup trop d’absurdités» avaient envahi ce champ de recherche dans les années 80 et 90 jusqu’à douter de son sérieux. «Un cirque à trois pistes avec une bande de dingos s’y promenant», brosse-t-il. Il ajoute que «n’importe qui dans la rue qui cherchait à se faire de l’argent était alors expert en vieillissement». Il raconte même avoir vu lors de conférences des gens déambuler en robe de chambre jouant aux «Pères Temps». «Les vrais scientifiques qui travaillaient sérieusement sur le sujet étaient denrée rare.»
Grande découverte
C’est avec le sentiment que cette quête n’était pas pour lui qu’il a poursuivi alors sa voie en biologie moléculaire. «Je voulais comprendre le mécanisme permettant à une protéine d’être transportée dans le noyau d’une cellule, ce qui fournit des indicateurs sur son fonctionnement.» Cancer, infections virales et troubles neurodégénératifs avaient révélé des failles lors de ce processus.
Après des recherches réalisées à l’Université de Californie à San Francisco sur l’import nucléaire des protéines, Michael Hall a décidé un jour de continuer ses travaux ailleurs. C’est alors que le biochimiste helvético-autrichien Gottfried Schatz l’a convaincu de le rejoindre au Biozentrum de Bâle, soit l’Institut de recherche en biologie moléculaire de l’Université de la ville rhénane.
Mais ses recherches en Suisse ont connu des débuts difficiles. Jusqu’à ce qu’un étudiant, Joe Heitman, rejoigne l’équipe après son doctorat. Ce dernier a suggéré d’étudier le fonctionnement des médicaments immunosuppresseurs pour savoir comment l’information passe de la surface cellulaire au noyau.
À l’époque, ce type de médicaments, comme la rapamycine, «étaient passionnants parce qu’à la base d’une révolution en médecine», rappelle Michael Hall. Ils rendaient les greffes d’organes viables en empêchant le système immunitaire d’être attaqué. «Ils ralentissaient la croissance des cellules immunitaires en bloquant l’importation nucléaire d’un signal». Mais à part ça, dit-il, «on savait peu de choses sur le fonctionnement de ces remèdes».
La découverte de la protéine TOR par Michael Hall et son équipe est le résultat d’un long parcours alambiqué. Lequel a débuté en 1964 lorsqu’un groupe de scientifiques canadiens est parti en expédition sur l’île de Pâques (ou Rapa Nui dans la langue locale) en quête de microbes exotiques susceptibles d’être utilisés en tant que remèdes. Des médicaments antifongiques. Ramenant des échantillons de ce voyage, ils les ont remis à d’autres scientifiques qui ont découvert dans l’un d’eux une espèce bactérienne produisant un composé aux propriétés immunosuppressives.
Ce composé a été baptisé rapamycine en référence à Rapa Nui. Puis celui-ci a été approuvé au titre de médicament immunosuppresseur par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration), afin de prévenir les rejets lors de transplantations d’organes. La rapamycine et ses dérivés, tels que l’everolimus par exemple, ont par la suite reçu le feu vert pour le traitement de différents cancers également.
C’est en étudiant la rapamycine dans des cellules de levure que Michael Hall et son équipe ont finalement fait des découvertes majeures durant la décennie suivante. Publiée en 1991 dans la revue ScienceLien externe, la première d’entre elles a permis d’identifier deux gènes qui étaient jusqu’alors inconnus — TOR1 et TOR2 — qui, une fois mutés, résistent aux effets de la rapamycine sur les cellules.
Son équipe a séquencé ce gène pour identifier la protéine encodée. D’autres recherches ont révélé ensuite que TOR remplissait un rôle de contrôleur central de la croissance cellulaire. C’est d’ailleurs l’une de ses découvertes les plus gratifiantes à ses yeux. «Avec du recul, il est incroyable de penser que cet aspect fondamental de la biologie n’ait pas été défriché plus tôt. Il y a tant de maladies comme le cancer basées sur une croissance cellulaire erratique.»
Après cette découverte, des entreprises de la pharma ont développé une nouvelle classe de médicaments pour combattre le cancer. Des bloqueurs de mTOR, dont l’everolimus vendu en Suisse sous le nom d’Afinitor par Novartis.
Du cancer à la longévité
Mettre à jour ce régulateur clé de la croissance cellulaire et du métabolisme a permis également de mieux décortiquer le vieillissement. Quand TOR ralentit sous l’effet d’un médicament comme la rapamycine ou à la suite d’un jeûne, il stimule le nettoyage d’une cellule, l’autophagie, laquelle perd en efficacité avec l’âge. Sans elle, les cellules gâtées s’accumulent, ce qui peut entraîner des maladies liées à l’âge comme l’ostéo-arthrite ou la neurodégénérescence.
Une autre grosse avancée remonte à 2003, lorsqu’un scientifiqueLien externe de l’Université suisse de Fribourg a découvert que le blocage de TOR chez les vers augmentait leur durée de vie de 20 à 30%. «C’était énorme et cette découverte a incité davantage de recherches sur TOR et le vieillissement», d’après Michael Hall.
Des scientifiques ont commencé à tester alors la rapamycine sur des mammifères présentant des similitudes génétiques avec les humains. En 2009, aux États-Unis, des chercheursLien externe ont pu ainsi établir qu’elle pouvait prolonger la durée de vie des souris de 14% chez les femelles et de 9% chez les mâles.
Mais Michael Hall s’est abstenu de travailler sur ces thèmes malgré des résultats de plus en plus significatifs. «J’avais à ce moment-là d’autres recherches à mener, laissant à d’autres l’étude de ces sujets», résume-t-il. Son intérêt s’est accentué par la suite malgré le battage médiatique entourant la longévité. Mais depuis, une rigueur scientifique était davantage appliquée.
Michael Hall est aujourd’hui souvent invité à s’exprimer lors de conférences sur ces thèmes. Et les milieux concernés louent de plus en plus ses découvertes. Dans son ouvrage Why We Die (pourquoi nous mourrons), le biologiste indo-américain Venkatraman Ramakrishnan, prix Nobel de chimie 2009, l’a d’ailleurs décrit comme «l’un des scientifiques vivants les plus éminents au monde».
Une science crédible
Le monde scientifique a en réalité encore beaucoup à apprendre sur l’influence de TOR sur la durée de vie des êtres humains. Mais les essais cliniques pour développer des médicaments pour retarder le vieillissement sont difficiles à entreprendre, car aujourd’hui non reconnus comme maladie par les organes de réglementation. Dès lors, faute de feu vert, les compagnies pharmaceutiques peinent à investir. Mais la recherche sur les animaux, elle, se poursuit. Dont un projet qui vise à étudier les effets de la rapamycine chez le chienLien externe par exemple.
Et en dépit de preuves d’efficience, une communauté d’enthousiastes de la longévité, toujours plus nombreuse, parie sur la rapamycine. En septembre 2024, au moins 20’000 personnes l’auraient prise aux États-Unis sous forme de pilule. Et leur nombre augmenterait de 300% par an, selon une plateformeLien externe en ligne consacrée aux personnes qui l’ont adoptée. De légères améliorations auraient été notées chez celles-ci allant de la perte de poids au soulagement de douleurs, selon un articleLien externe paru en septembre dernier dans le New York Times.
Mais la rapamycine n’est pas sans risque. L’un de ses plus grands défenseurs et fondateur du mouvement Don’t Die (ne meurs pas), Bryan Johnson, a annoncé en décembre dernier sur le réseau Instagram qu’il avait cessé lui-même d’en prendre après cinq ans d’expérimentation à cause d’effets secondaires. En l’occurrence des infections des tissus mous à une hausse de la fréquence cardiaque au repos.
D’autres experts de la longévité restent optimistes. «Il y aura sans doute à terme de meilleurs médicaments. Mais la rapamycine est aujourd’hui le plus prometteur», avance Brian Kennedy de l’Université nationale de Singapour, un des chercheurs les plus écoutés sur le sujet. En effet, selon lui, il est le seul à avoir réussi à prolonger de façon cohérente la durée de vie de différentes espèces.
Pour Michael Hall, si la rapamycine, qu’il ne consomme pas lui-même, n’est pas la pilule magique sur laquelle beaucoup pourraient compter, «tout médicament pour prolonger la durée de vie nous ramènera inévitablement au gène TOR».
Texte relu et vérifié par Nerys Avery, traduit de l’anglais par Alain Meyer/op

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative









Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.