Dans la peau d’un réfugié

Comment survivre à la violence de la guerre? Dans quel état arrive-t-on dans le pays d'accueil après avoir vécu ces traumatismes?
Une quarantaine de jeunes adultes en ont fait l’expérience lors d’un jeu de rôle. Reportage.
Jean-Daniel Muller n’en est pas à son coup d’essai. Ni son équipe d’animateurs, tous réfugiés politiques établis en Suisse depuis une dizaine d’années.
Pantalon de baroudeur, T-shirt et baskets, le responsable romand du programme «Passages» de l’Organisation d’aide aux réfugiés (OSAR) introduit le jeu de rôle en brossant un rapide portrait de la situation de l’asile en Suisse.
Face à lui, dans une salle bétonnée d’un abri labyrinthique de la Protection civile à Villars-sur-Glâne (FR), une quarantaine de futurs travailleurs sociaux de la Haute école spécialisée (HES) de Givisiez.
«Il s’agit de comprendre ce qu’un réfugié a dû traverser. Car l’exil ne supprime pas tous les éléments menaçants. Il va devoir apprivoiser une nouvelle culture, faire le deuil de son ancienne vie pour dépasser les persécutions».
Kais Fguiri, coordinateur romand du projet «Ecole» de l’OSAR, rappelle aussi que l’exil touche 50 millions de personnes et que le problème s’est internationalisé.
Plongée dans la violence
Le jeu peut alors commencer. Chacun reçoit un bandeau, qui selon la couleur indique à quelle famille nous appartenons. Ainsi qu’un carton SOS, à brandir en cas de malaise…
Voilà qui pose le décor, l’ambiance, bon enfant, se tend quelque peu. Aveuglés par le bandeau, on nous positionne dans la pièce. Et là, en une fraction de seconde, la terreur nous assaille sous la forme d’un bombardement d’une violence extrême.
La plupart des étudiants restent pétrifiés, assommés par le fracas des bombes, des mitrailleuses, étouffés par la fumée. Les autres sont prostrés sur le sol, en position fœtale, dans l’espoir d’un refuge illusoire.
«J’avais les larmes aux yeux, c’était insupportable. C’est autre chose qu’à la télévision», confessera plus tard une jeune femme qui faisait référence aux images aseptisées de la toute récente guerre en Irak.
Ce traumatisme initial est bien sûr voulu. Les participants oublient en quelques secondes leur quotidien. Ils sont alors préparés émotionnellement à vivre la suite du parcours.
La fuite s’organise
Les bombardements s’arrêtent enfin. Hagards, les participants sont alors bousculés: il faut fuir, le village est détruit, les alentours grouillent de militaires.
L’ennemi n’est pas clairement identifiable, la menace diffuse. En deux minutes, il faut décider ce qu’on va emporter: un objet par personne.
Chacun agit selon le profil qui lui est assigné, – qui un grand-père, un enfant ou un adulte. Certains parlent des langues étrangères. D’autres n’ont rien, ni argent, ni valeurs à échanger lors de la fuite.
Et ce qui va s’avérer une fuite sans fin commence alors, dans le chaos et l’anarchie la plus totale.
A peine sorti au grand air, le groupe se fait attaquer par surprise par des militaires, totalement crédibles. En treillis et armes dégainées, ils rackettent alors les participants qui se voient délestés de leurs bijoux.
Et puis, les hommes valides sont emmenés à l’écart. On les retrouve alignés, à genou, tournant le dos à leurs agresseurs qui les insultent et les brutalisent. Comme les femmes restées dans le groupe.
Passer la frontière
Finalement, les fuyards trouvent un refuge temporaire dans un souterrain. La panique initiale commence à se calmer. Mais pas la peur, jamais.
C’est alors que la fuite va s’organiser quelque peu, la seule issue viable étant de passer dans le pays voisin. Oui, mais comment, dans un pays ravagé par la guerre, avec groupes paramilitaires et réfugiés jetés en pagaille sur les routes.
Et c’est là que les passeurs entrent en scène, un jalon incontournable dans le parcours du réfugié. Qui va d’ailleurs y laisser ses dernières valeurs.
«On ne sait plus à qui faire confiance, c’est très éprouvant, remarquera un étudiant lors du débriefing. On perd tous repères, on a peur de tout le monde».
Et à raison. Car après avoir marché pendant ce qui devait être de longues nuits, en silence, à travers des champs de mines factices, le groupe de réfugiés arrive à la frontière qui reste fermée.
Les passeurs menacent de nous abandonner, à la merci de garde-frontières nous tenant en joue. Il va falloir, une fois de plus, payer. Et tant pis pour ceux qui ne peuvent pas.
Camp du HCR
Et de l’autre côté de la frontière, contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’arrivée dans le camp du Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) ne signifiera pas la sécurité pour autant.
Les fuyards doivent faire face à l’agressivité des police et population locales face à l’arrivée massive de réfugiés «qui vont leur voler leurs femmes et leur travail».
Les participants, à quarante dans dix mètres carrés, font vite l’expérience de la promiscuité. «C’est intolérable et surtout inimaginable qu’une femme doive accoucher dans un passage», selon un des étudiants.
Sans compter l’espoir que suscite l’arrivée d’un fonctionnaire occidental chargé de présenter des candidats à l’asile aux autorités de son pays. Et de constater l’arbitraire qui conduit ces procédures, les familles séparées par des critères d’admissions souvent incompréhensibles.
Et c’est là que le jeu de rôle s’arrête. Les participants, ébranlés et épuisés, auront ensuite bien besoin des 45 minutes de débriefing pour retrouver leurs esprits. Et exprimer ce qu’ils ont ressenti, à quel point ils étaient désemparés.
Certes, la démarche a ses limites. Ce n’est finalement qu’un jeu de rôle dont on s’extrait facilement. Mais elle semble avoir touché juste. L’exil forcé du réfugié a soudain pris une tournure sacrément humaine.
swissinfo, Anne Rubin

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
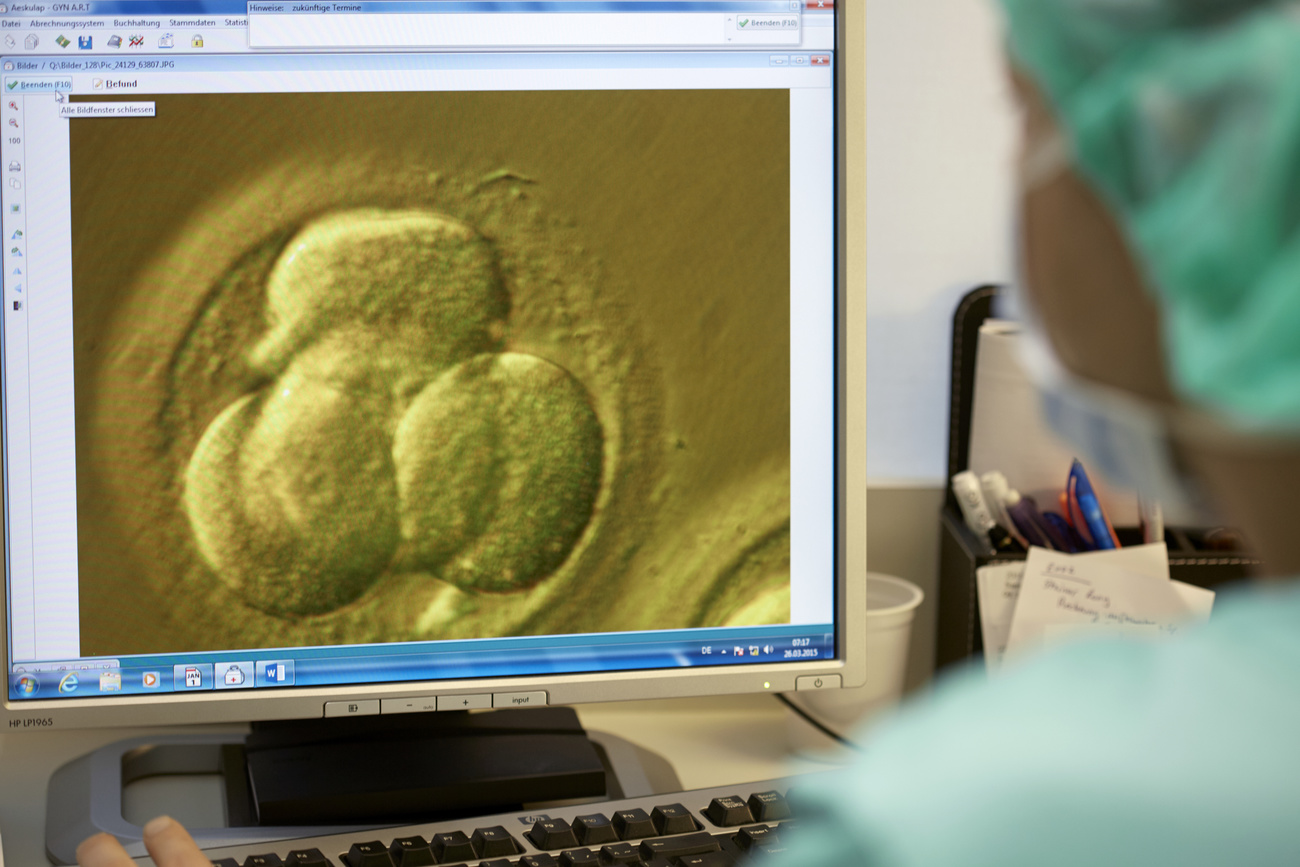





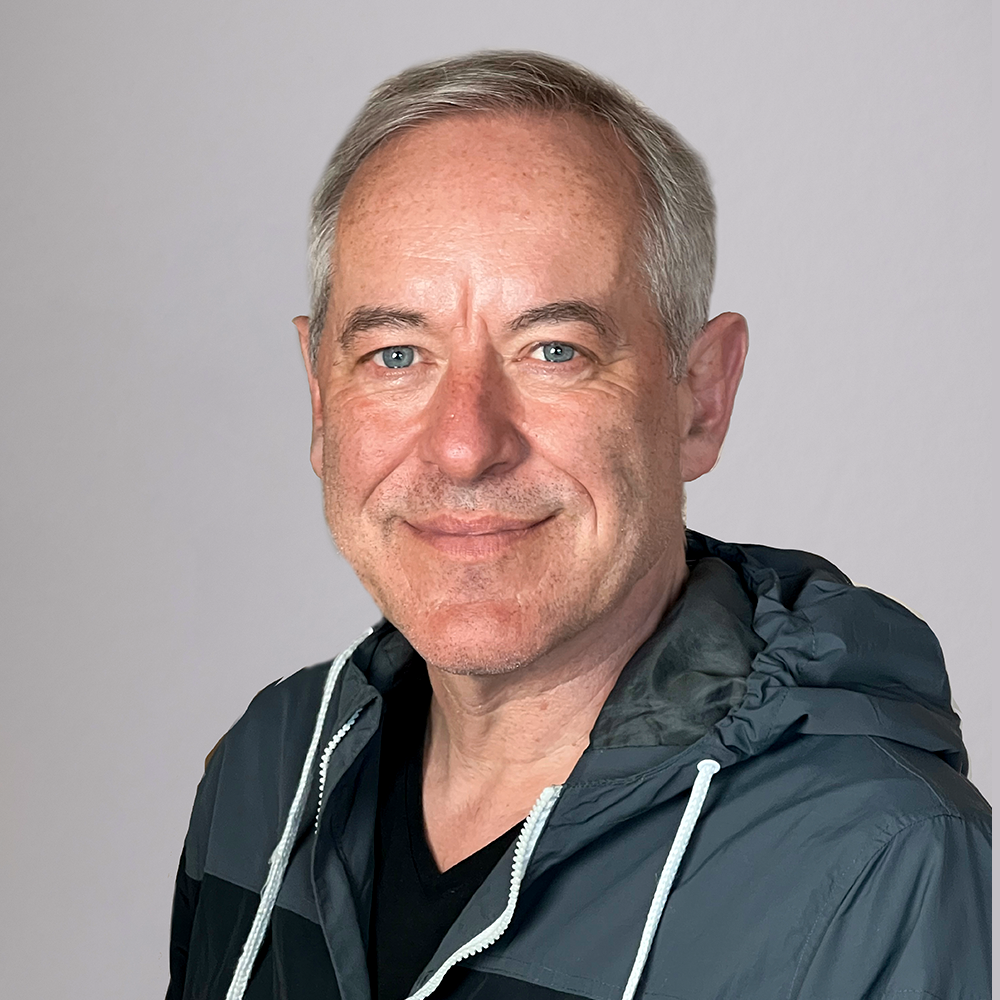

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.