
Genève, un tram d’avance

La grève des chauffeurs des transports publics a paralysé Genève jeudi. En Suisse, on n'avait plus vu de mouvement d'une telle ampleur depuis longtemps.
Une journée entière de grève. Pourtant, la direction des Transports publics genevois (TPG) avait cédé en grande partie aux revendications des syndicats.
Concrètement, elle avait proposé de réaménager les horaires, de moderniser le parc des véhicules et d’augmenter les effectifs. Mais les quelque 800 employés des TPG ont décidé de ne pas reprendre le travail immédiatement.
«C’est un mouvement de sanction, explique le Syndicat des conducteurs TPG. Cela fait trop longtemps que nous nous plaignons des mauvaises conditions de travail.»
Un cas rare
Un mouvement d’une intensité quasi unique en Suisse dans le secteur des transports publics urbains.
«De mémoire, confirme François Gatabin, vice-président du Syndicat du personnel des transports (SEV), on n’avait plus vu de grève de cette ampleur-là depuis plus de 80 ans en Suisse»,
La dernière grande mobilisation dont on se souvient dans le milieu syndical remonte à 1918. A la grève générale des cheminots.
Depuis, il y a bien eu des débrayages, mais de courte durée. Ou encore quelques préavis de grève, qui ne se sont pas souvent concrétisés.
Le Syndicat des services publics (SSP), qui couvre la Suisse alémanique, évoque le cas de Zurich.
Des mouvements avaient été amorcés au début des années 90, lors de la libéralisation des transports publics. Un préavis avait été lancé, mais les deux parties étaient parvenues à un accord avant que la grève ne se concrétise.
Une particularité genevoise?
Le SSP donne encore l’exemple de Thoune et de Saint-Gall. Et sinon… de Genève. Déjà!
Le Syndicat des conducteurs TPG se souvient de quelques arrêts de travail, là encore au début des années 90. En 1995 notamment. Mais le débrayage n’avait duré que deux heures.
Le SEV n’est pas surpris de constater que ce mouvement revit à Genève précisément. «Je pense, précise François Gatabin, qu’il y a une sensibilité différente entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.»
«Le service public est perçu différemment de part et d’autre, poursuit le vice-président du SEV. En Suisse romande, on est encore très attaché à l’Etat providence, à l’Etat protecteur.»
Et d’ajouter: «En Suisse alémanique, on est peut-être proche d’idées plus libérales. On accepte plus facilement de déléguer au privé».
«Le partenariat social n’est pas non plus vécu de la même manière, estime François Gatabin. Les Alémaniques sont plus consensuels et plus pragmatiques que les Romands.»
L’exemple de Swissair
Une tendance qui s’est vérifiée à plusieurs reprises. Entre autres, avec les différences de réaction syndicales, à Genève et à Zurich, lors de la débâcle de Swissair.
Autre exemple: l’abolition du statut de fonctionnaire qui a suscité des oppositions plus marquées côté romand que côté alémanique.
Et si on ajoute à cela la proximité de la France… On comprend pourquoi Genève, plus encore que la Suisse romande, fait office de locomotive syndicale.
swissinfo/Alexandra Richard

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
























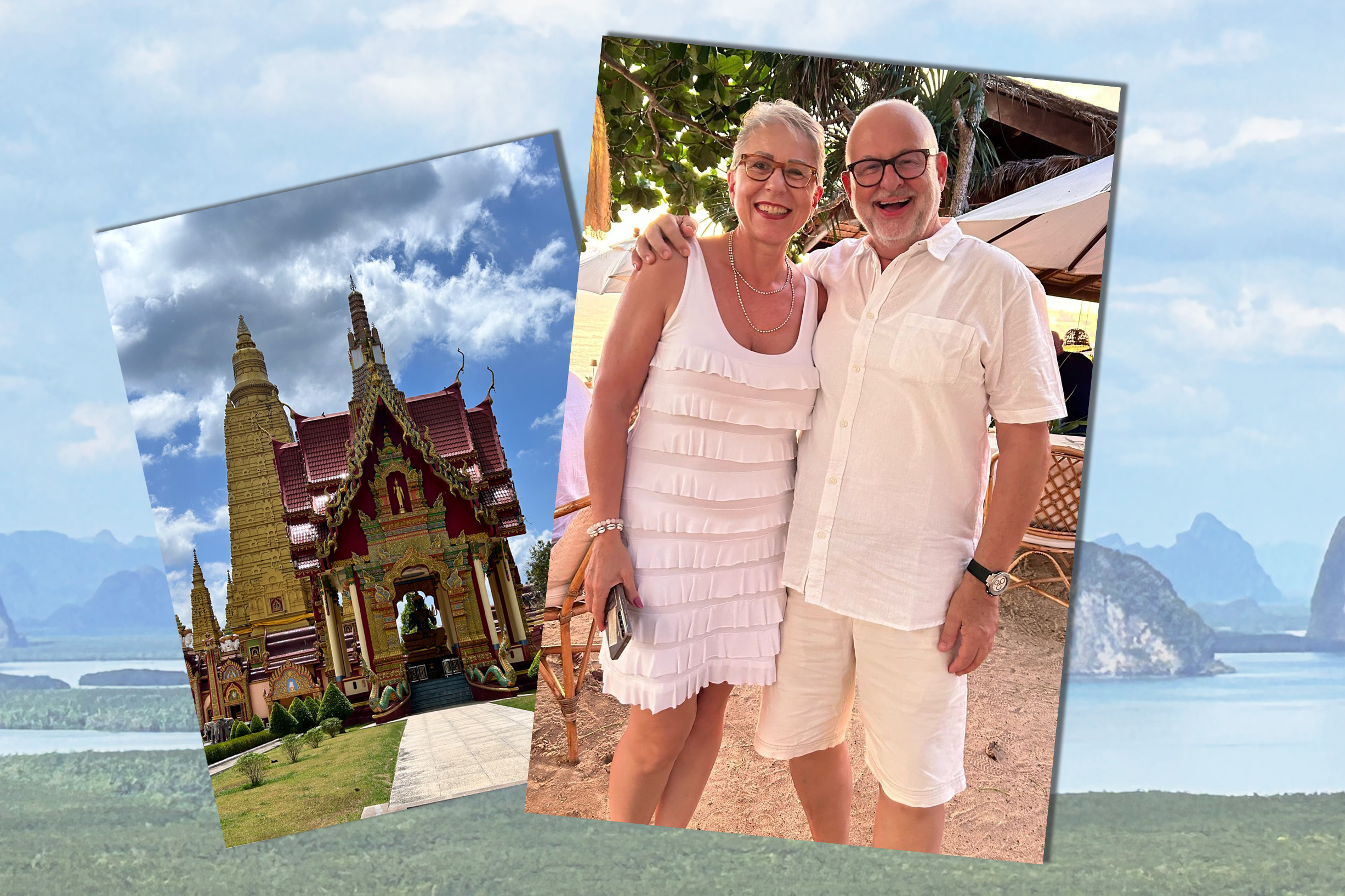







Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.