
Valentin, l’autre prénom fleuri de Max Havelaar

Le commerce équitable peut aussi se conjuguer avec des fleurs. En Suisse, une rose sur dix importée du Sud porte déjà le label Max Havelaar.
Max Havelaar, personnage de roman hollandais, aurait-il un jour imaginé offrir à sa mie quelque fleur outremer? Une chose est sûre: ceux qui ont repris son patronyme pour défendre la dignité et les intérêts des producteurs du Sud ont inscrit ce rêve dans leur catalogue. Et s’en réjouissent.
C’est que les fleurs, les Suisses aiment en offrir. Chaque année, pour cela, ils n’hésitent pas à sortir en moyenne plus de 120 francs de leur porte-monnaie. Ce qu’ils savent moins, sans doute, c’est qu’une rose sur quatre vendue en Suisse vient d’un pays du Sud.
Un geste de solidarité
Au printemps 2001, la Fondation Max Havelaar avait convaincu quelques-uns de ses grands partenaires helvétiques de lancer, sur le marché, des fleurs coupées portant le label du commerce équitable. Le geste d’offrir et de recevoir un bouquet prenait du même coup une plus-value de solidarité.
Solidarité féminine, de surcroît. Car, nous dit Paula Ghillani, présidente de la Fondation Max Havelaar Suisse, «plus que les fleurs, ce qui nous préoccupait, c’était la problématique des travailleuses et de leurs conditions de travail dans ce secteur agricole des pays en développement».
Démarrage réussi, dit-on au siège bâlois de la Fondation qui ne s’attendait pas à pareil succès. 1,2 millions de bouquets de roses étiquetés Max Havelaar ont été vendus en neuf mois. A tiges courtes ou longues, ils provenaient essentiellement d’Afrique de l’Est: Kenya, Zimbabwe, Zambie.
La «prime du commerce équitable» ainsi dégagée dépasse déjà les 300 000 francs. Ce montant a été réparti entre 17 exploitations floricoles qui répondent aux critères de certification de la Fondation et qui emploient plus de 8’000 personnes, en majorité des femmes.
Du bon usage du label
Faut-il rappeler la «méthode Havelaar»? D’un côté, les distributeurs: ils s’engagent à payer des produits à un prix minimum, ainsi qu’un supplément destiné à un fonds de développement social. De l’autre, les producteurs: leurs organisations décident démocratiquement de l’usage de ce surplus.
Grâce aux fleurs, quelques projets sont déjà en route. Pour améliorer les conditions de vie des ouvrières, faciliter l’approvisionnement en eau, développer les structures scolaires, acheter quelques équipements de base, vélos, machines à coudre ou autres.
Pourquoi l’Afrique seulement, alors qu’une part importante du marché suisse des roses provient d’Amérique latine? Il faut chercher la réponse du côté de certains propriétaires qui hésitent à céder des droits d’association à leurs employés.
«En Équateur, explique Paula Ghillani, c’est cela qui freine nos projets et qui nous fait mal au cœur.» Car l’objectif du mieux-être social et environnemental reste la condition sine qua non du label. L’important, c’est la rose équitable.
Jaune et florissimo
Max Havelaar vérifie la conformité des labels mais ne fait pas commerce. Par contre, la Fondation s’efforce de convaincre les grands distributeurs du bien-fondé de sa démarche. Manifestement, le message passe. Grâce surtout à l’engouement des consommateurs.
Ainsi Migros, qui a participé à la définition des critères pour les fleurs produites dans des conditions équitables, éthiques et environnementales. Elle décline désormais son propre Max Havelaar «Florissimo» jaune. Et contribue, par exemple, au programme «fair trade» au Zimbabwe.
Mais, d’un point de vue écologique, n’y a-t-il pas contradiction à prôner simultanément le «légume local de saison» et le bouquet tropical disponible été comme hiver? Paula Ghillani accepte l’argument.
Si la Fondation Max Havelaar, après de longues hésitations, a passé outre, c’est parce qu’un autre souci pesait dans la balance: «le commerce des fleurs existait déjà, mais on n’y prêtait aucune attention aux problèmes sociaux et environnementaux, c’est ça qu’on a voulu changer».
Bernard Weissbrodt

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative























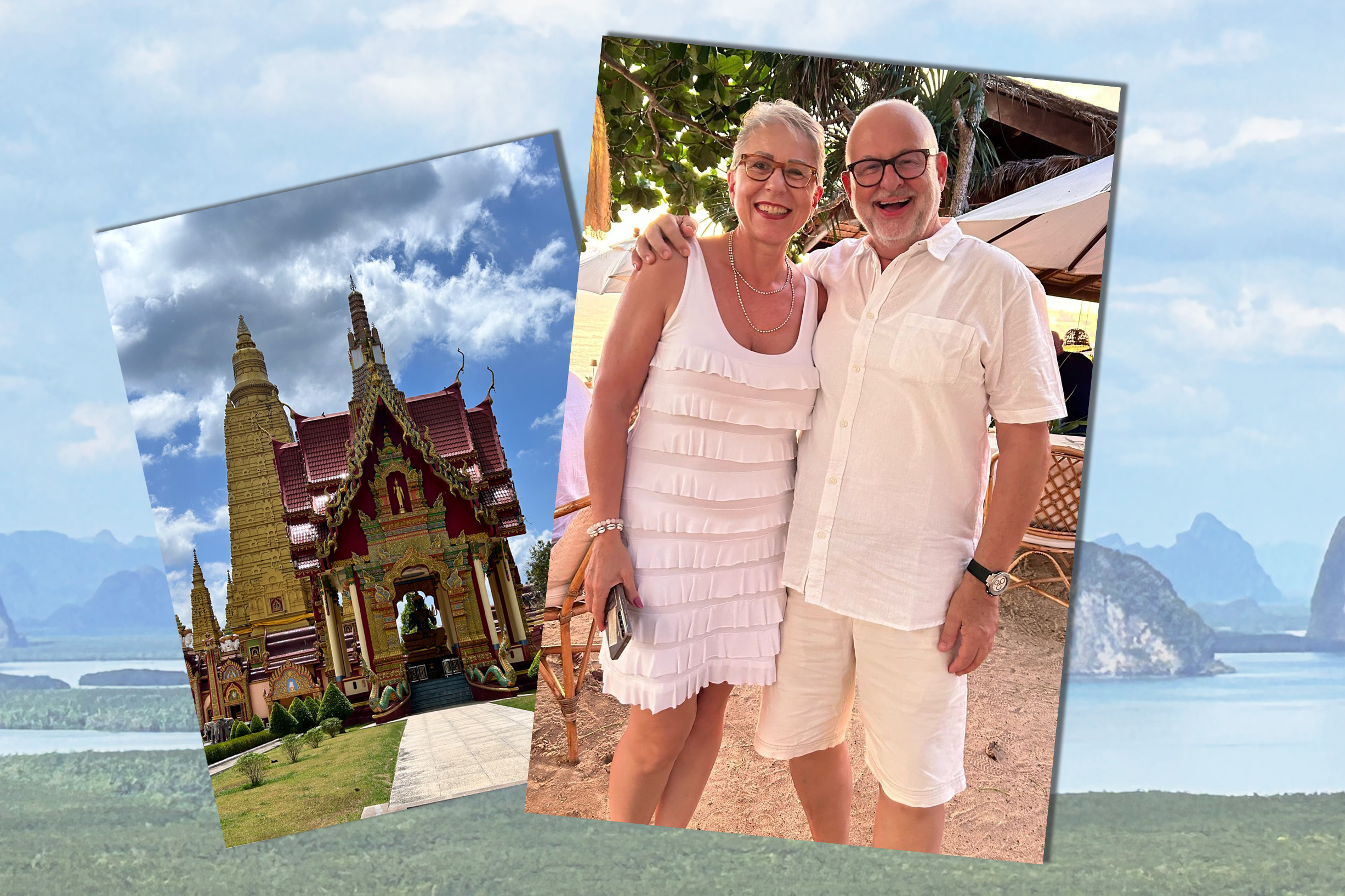







Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.