
La fibre optique met au jour les vagues invisibles qui font fondre les glaciers du Groenland

Les masses de glace qui se détachent des glaciers accélèrent la fonte de l’inlandsis du Groenland. C’est ce que vient de montrer un groupe de recherche international au moyen d’une technologie à fibre optique aussi utilisée dans l’étude des glaciers suisses.
La calotte glaciaire (inlandsis) du Groenland fond de plus en plus vite. Depuis 2002, elle a perdu 270 milliards de tonnes de glace par anLien externe en moyenne, provoquant une élévation du niveau des océans de près de deux centimètres.
Le décrochement de gros blocs de glace (vêlage) est un des effets les plus visibles de la perte de masse de l’inlandsis causée par le changement climatique. Un phénomène qui, à son tour, intensifie la fonte. Car l’effondrement d’un iceberg dans la mer fait remonter en surface de l’eau plus chaude, ce qui accélère le processus de fonte du glacier.
C’est la découverte signée par un groupe de recherche international mené par les universités de Zurich et de Washington, qui a pour la première fois mesuré la manière dont la dislocation des glaces accélère le recul de la calotte arctique du Groenland. Partie intégrante du projet GreenFjord de l’Institut polaire suisse, l’étude vient d’être publiée le 13 août dans NatureLien externe.
«Nous comprenons mieux le processus intervenant lorsque la glace tombe dans la mer. La glace ne fait pas que se détacher, elle accroît aussi la fonte sous la surface de l’eau», explique à Swissinfo Andreas Vieli, professeur de glaciologie à l’Université de Zurich et coauteur de l’étude.
Ces observations permettent d’améliorer les connaissances au sujet des glaces du Groenland, déployées sur une superficie de quarante fois la Suisse. Un système fragile dont la fonte complète aurait de graves conséquences sur les courants océaniques, le climat et les zones côtières de la planète.
>> La fonte des glaciers a des conséquences planétaires:
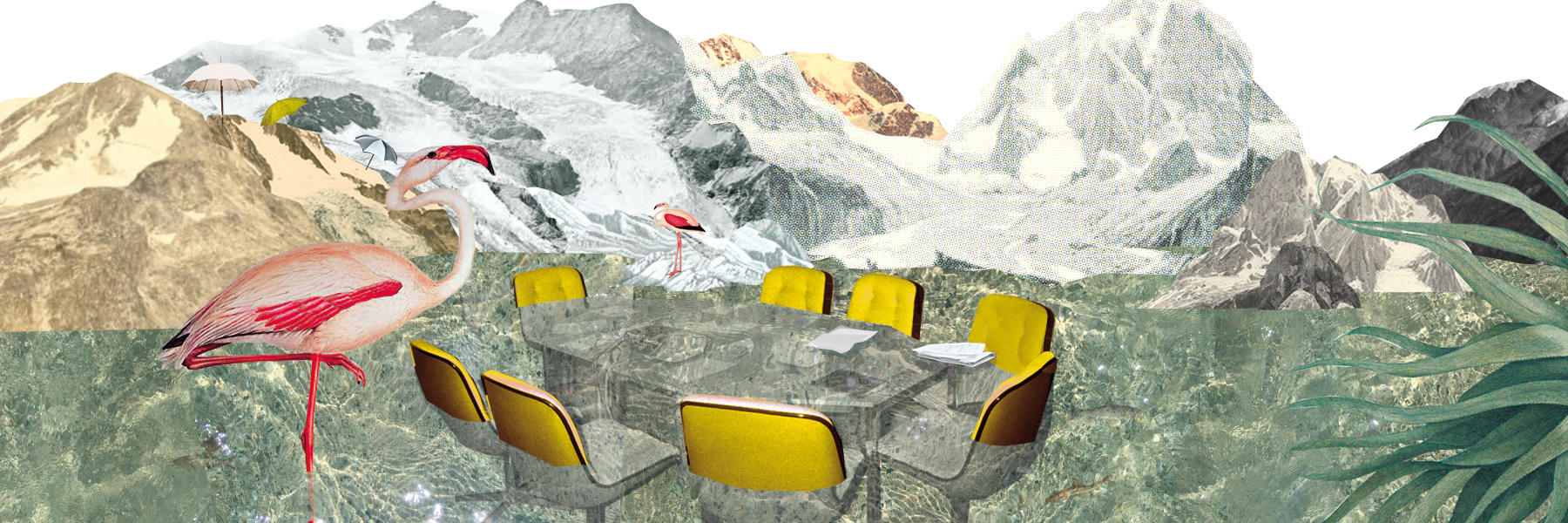
Plus
Pourquoi la fonte des glaciers nous concerne
Des vagues géantes ramènent l’eau chaude en surface
Les équipes de recherche des universités de Zurich et Washington ont étudié les effets du vêlage sur le glacier Eqalorutsit Kangilliit Sermiat, sis dans un fjord du sud du Groenland. Cette langue glaciaire perd 3,6 km3 de glace chaque année. Près de trois fois le volume du glacier du Rhône, dans les Alpes suisses.
L’impact de la glace chutant dans la mer produit des vagues de surface, similaires à des tsunamis, qui agitent la partie supérieure de la colonne d’eau. Mais le vêlage provoque aussi des vagues en profondeur, invisibles à l’œil nu. Elles peuvent avoir la hauteur d’un gratte-ciel et ramènent l’eau chaude des profondeurs vers la surface, intensifiant les processus de fonte et d’érosion du front du glacier.
>> Découvrez les images spectaculaires de l’effondrement d’une section d’un glacier du Groenland:
Chercheur à l’université de Washington et auteur principal de l’étude, Dominik Gräff compare ce processus à la fonte d’un glaçon dans une boisson chaude. Si on ne remue pas, une couche d’eau froide se forme autour du glaçon, l’isolant du liquide plus chaud. En mélangeant, cette couche est perturbée et le glaçon fond beaucoup plus rapidement.
S’agissant de la calotte glaciaire du Groenland, la moitié environ de la perte de masse actuelle est due à la fonte sous-marine et au détachement d’icebergs, précise Andreas Vieli.
De la fibre optique dans les fonds marins du Groenland
Pour mesurer ce qui se passe en profondeur, chercheuses et chercheurs ont posé un câble à fibre optique long de dix kilomètres sur le fond marin. Au moyen de la technologie dite Distributed Acoustic Sensing (DAS), ils ont enregistré les déformations de la fibre – allongement ou compression – causés par les vagues sous-marines.
«Le câble à fibre optique nous a permis de mesurer cet effet multiplicateur incroyable de la rupture de la glace, chose impossible jusque-là», assure Dominik Gräff dans un communiquéLien externe de l’Université de Zurich.

L’importance de l’eau de mer et des dynamiques de détachement des icebergs est connue de longue date. Mais les mesurer directement sur le terrain présente de grosses difficultés. Le nombre élevé d’icebergs dans les fjords signifie un risque constant de chute de masses de glace.
Qui plus est, les méthodes traditionnelles de télédétection par satellite n’agissent pas sous la surface de l’océan, où se produisent les interactions entre eau de mer et glaciers, explique Andreas Vieli. «Avec le câble à fibre optique, nous disposons virtuellement d’un millier de capteurs sous le front du glacier.»
Une technologie utilisée sur les glaciers suisses
Le recours à la fibre optique dans l’étude les glaciers est relativement récent. En Suisse comme en Alaska et d’autres régions montagneuses, les scientifiques ont commencé à l’utiliser pour détecter micro-vibrations et autres signaux potentiellement annonciateurs d’instabilité au sein de glaciers.
«La fibre optique nous permet de détecter des événements sismiques extrêmement faibles, que d’autres technologies ne sont pas même de mesurer», a indiqué à Swissinfo le sismologue de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) Thomas Hudson.
En 2023, ce dernier a installé 1,2 km de câbles à fibre optique sur le glacier suisse du Gorner. Il y a enregistré des milliers d’ondes sismiques. Des vibrations aptes à fournir des indications sur les changements intervenant dans le glacier.
>> Des projets de recherche sur la fibre optique en Suisse ouvrent de nouvelles perspectives dans la surveillance des glaciers et des risques naturels:

Plus
La fibre optique pourrait affiner la prévision des effondrements de glaciers
La fibre optique est aussi source d’informations sur la structure et la composition du glacier. Son avantage par rapport aux capteurs sismiques traditionnels, placés à des endroits bien spécifiques, est la possibilité de monitorer des surfaces nettement plus vastes du fait de sa relative facilité d’installation.
Cette technologie permettrait de surveiller des glaciers dans leur entier, y compris en terrain difficilement accessible.
Texte relu et vérifié par Reto Gysi von Wartburg, traduit de l’italien par Pierre-François Besson/ptur

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative


























Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.