

Le long chemin vers le droit de vote des femmes
Les premiers pays à avoir introduit le suffrage féminin l’ont fait à la fin du XIXe siècle. Depuis 1948, le droit de vote est considéré comme un droit humain universel. Mais en Suisse, les hommes ont continué à tenir les femmes à l’écart de la vie politique pendant des décennies. Pourquoi l’introduction du suffrage féminin a-t-elle pris autant de temps?
Les femmes suisses ont obtenu le droit de vote au niveau fédéral en 1971. Mais les citoyennes du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures ont dû attendre jusqu’à la fin de la Guerre froide. Le gouvernement suisse est finalement intervenu pour obliger les autorités locales à donner aux femmes des droits politiques égaux à ceux des hommes.

Plus
1991, l’année où le dernier bastion masculin de Suisse est tombé
En comparaison internationale, le suffrage féminin a été introduit tardivement en Suisse. La Confédération est très en retard par rapport aux autres pays occidentaux.

Plus
La lutte mondiale pour le suffrage féminin
Parmi les arguments avancés par les opposants au suffrage féminin revenait souvent l’idée que la femme n’était pas faite pour la politique. Les affiches montraient des enfants négligés, tombant de leur berceau, en pleurs devant des portes fermées ou infestés de mouches… Certains hommes avaient peur que les femmes mettent la famille et le ménage de côté en s’intéressant davantage à la politique.
Des préjugés qui étaient également très répandus dans d’autres pays.
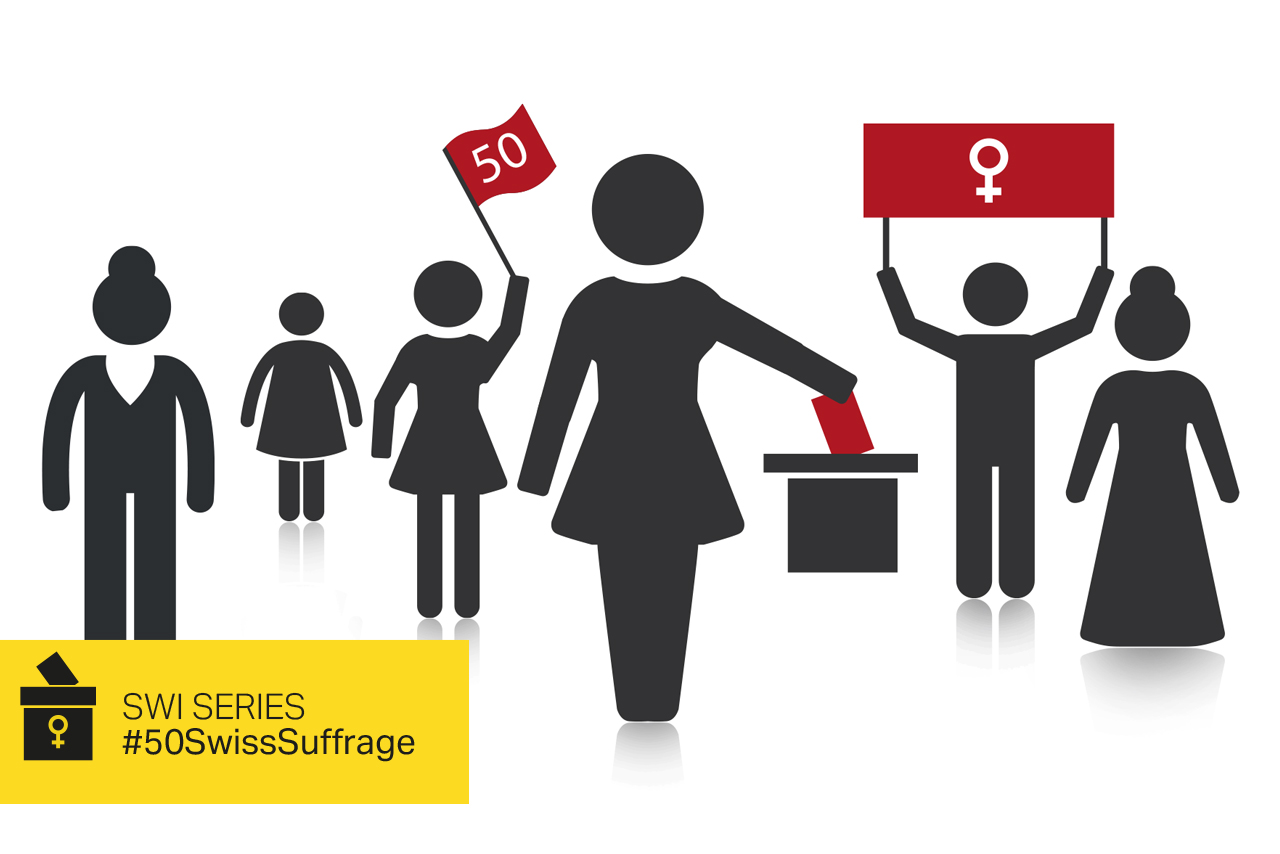
Plus
L’introduction du suffrage féminin dans le monde
Et pourtant, les femmes suisses ont commencé très tôt à revendiquer leur droit de participer à la vie politique. En 1868, la Genevoise Marie-Goegg Pouchoulin fonde l’Association internationale des femmes, la première organisation internationale de femmes.
En 1886, l’écrivaine Meta von Salis fait une tournée de conférences en Suisse et dénonce à maintes reprises l’inégalité de traitement subie par les femmes. En 1896, le premier congrès national des femmes se tient à Genève. Une des principales demandes: le droit de voter et d’être élue.

Plus
«Sans droit de vote des femmes, la Suisse n’est pas une démocratie»
Si la Première Guerre mondiale a été le déclencheur du suffrage féminin dans d’autres nations européennes, ce ne fut pas le cas en Suisse. Les tentatives faites dans les cantons ont échoué. Même après la Seconde Guerre mondiale, le droit de vote des femmes n’avait aucune chance de passer le cap des urnes, que ce soit au niveau local ou national.
Lorsque le Conseil fédéral a proposé en 1957 que les femmes soient également obligées d’effectuer une sorte de service militaire, une grande indignation s’est levée. Dans un village du canton du Valais, Unterbäch, un vote de protestation a fait parler de lui jusque dans les médias internationaux: des femmes ont voté illégalement en se rendant aux urnes et en y glissant leur bulletin. Leurs voix ont été invalidées.

Plus
Les femmes d’Unterbäch
Alors que dans d’autres pays, le suffrage féminin a été introduit par les représentants politiques élus, en Suisse ce sont les citoyens masculins qui ont dû voter pour renoncer à leur propre privilège. La question de savoir qui appartient au «peuple» et jouit d’une participation politique est toujours à l’ordre du jour, car d’autres groupes sont encore exclus de certains droits politiques, par exemple les étrangers ou les personnes en situation de handicap.

Plus
Quand la Suisse était une démocratie d’exclusion
L’introduction du suffrage féminin a commencé au niveau local: d’abord dans certains villages, puis dans les cantons de Vaud et de Genève. Dans les années 1960, une nouvelle génération de militantes est entrée dans l’arène politique. Elle ne s’appuyait plus sur son réseau ou le lobbying auprès des hommes, mais sur la rébellion.
Plus
Les associations de femmes ont organisé des manifestations, des bocages et des actions dans tout le pays pour réclamer le droit de vote. En 1969, elles ont marché sur la Berne fédérale pour faire entendre leur voix.

Plus
Il y a 50 ans, les femmes manifestaient pour le droit de vote
Le Conseil fédéral a voulu signer la Convention européenne des droits de l’homme avec une clause qui excluait les droits politiques des femmes. Mais face aux vives protestations, il a décidé de procéder à un nouveau vote national sur le suffrage féminin en 1971. Et cette fois deux tiers des votants ont dit «oui».

Plus
«Défendez vos droits», conseille Hanna Sahlfeld-Singer aux jeunes femmes
Cette décision n’a toutefois pas résolu du jour au lendemain toutes les discriminations à l’encontre des femmes. Jusqu’en 1976, celles-ci n’étaient pas autorisées à accepter un emploi sans le consentement de leur mari. Et le viol conjugal n’a été considéré comme une infraction que dans les années 1990. Toutefois, les femmes avaient désormais leur mot à dire pour tenter d’améliorer la situation. Même si la parité n’est encore pas atteinte dans les instances politiques suisses, et de loin.

Plus
En politique suisse, les femmes sont encore loin du but

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

























