
Réchauffement climatique: solution dans les étoiles

Des scientifiques de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (Cern) à Genève cherchent à déterminer quelle est l'influence du rayonnement cosmique sur notre environnement.
Une nouvelle expérience a pour but de découvrir comment les rayons cosmiques et le soleil peuvent influencer la formation de nuages de basse altitude, et de ce fait modifier le climat.
Il y a plus de deux siècles, l’astronome royal britannique William Herschel a découvert une corrélation entre les taches solaires – qui sont des indicateurs de l’activité du soleil – et le prix du blé en Angleterre. Lorsque les taches étaient peu nombreuses, les prix montaient, suggérait-il.
Jusqu’à récemment, peu d’éléments sont venus confirmer cette hypothèse. Aujourd’hui, dans un bâtiment du Cern que d’aucuns taxeraient de décrépit, l’expérience Cloud (Cosmic Leaving OUtdoor Droplets) pourrait aider à comprendre comment le rayonnement solaire affecte le climat.
Ce sont des chercheurs danois qui ont suggéré les premiers, il y a de cela une dizaine d’années, que les rayons cosmiques générés par l’explosion des étoiles (supernovas) contribuaient à créer des nuages de basse altitude.
Gouttelettes de nuages
Selon eux, la pénétration du rayonnement cosmique dans l’atmosphère terrestre accélère la formation d’aérosols ou de groupes de molécules. En grossissant, ces derniers sont susceptibles de constituer la base des gouttelettes formant les nuages.
Or un nuage qui contient un nombre important de gouttelettes reflète la lumière solaire plus efficacement et produit un effet de refroidissement. Les experts estiment que des fluctuations de quelques pourcents au niveau de la masse globale des nuages pourraient avoir une influence significative sur le climat de la terre.
«Nous voulons reproduire ce qui arrive dans l’atmosphère», explique Jasper Kirkby, qui dirige l’équipe Cloud du Cern. «Nous voulons comprendre comment il est possible de passer d’un rayon cosmique à une gouttelette de nuage, et dans quelle partie de l’atmosphère cela pourrait se passer».
Projet interdisciplinaire
Au Cern, un faisceau de particules imitant les rayons cosmiques, généré grâce à un accélérateur à haute énergie, passe par un détecteur puis est envoyé vers une « chambre de réactions ». Les conditions qui prévalent à l’intérieur de celle-ci imitent celles de l’atmosphère terrestre.
Le prototype complet du détecteur, qui nécessiterait une chambre de réactions plus sophistiquée et une autre chambre pour fabriquer des nuages, ne sera pas prêt avant 2010.
En ajustant la température et la pression dans la chambre, les scientifiques peuvent reproduire les conditions qui dominent à différentes altitudes et latitudes. Ils espèrent ainsi réussir à déterminer lesquelles sont les plus favorables à la formation des aérosols.
Ce projet interdisciplinaire est le premier pour lequel un accélérateur à particules est utilisé dans le but de comprendre le climat. «Il a fallu près d’une décennie pour surmonter quelques idées préconçues», relève Jasper Kirkby.
Lien pas prouvé
«Avec une expérience interdisciplinaire comme Cloud et un sujet de recherche qui est en avance sur son temps, il a été difficile de trouver un financement a-t-il confié à swissinfo. Ce projet n’entre pas dans un cadre normal», fait-il encore remarquer.
Le scepticisme affiché par la communauté scientifique quant au lien entre les rayons cosmiques et le climat constitue également un problème.
«Ce lien n’est pas prouvé pour le moment, indique Urs Neu, du Forum suisse pour le climat et le changement global. Les incertitudes sont nombreuses. On ne sait pas si ces radiations ont un effet ou non.»
Les premiers résultats de l’expérience Cloud sont attendus pour l’été prochain. Les données du projet complet devraient être disponibles dès 2010. D’ici là, l’équipe de Jasper Kirkby a l’assurance de pouvoir poursuivre ses recherches.
swissinfo, Scott Capper à Genève
(Traduction et adaptation de l’anglais: Carole Wälti)
Douze Etats dont la Suisse ont fondé le Cern en 1954. Vingt Etats en font actuellement partie.
Environ 6500 scientifiques travaillent au Cern, soit la moitié des spécialistes en physique des particules du monde, issus de quelques 500 centres universitaires.
Le Cern est en train d’achever la construction du Grand Collisionneur Hadronique qui devrait être opérationnel en 2007.
Devisé à 3 milliards de francs, ce sera le plus puissant accélérateur de particule de la planète. Il devrait permettre de grandes avancées dans la compréhension des lois fondamentales de l’univers.
Le World Wide Web est né au Cern d’un projet baptisé Enquire (s’informer) mené par l’expert en informatique Tim Berners-Lee en 1989.
Le projet Cloud réunit une équipe interdisciplinaire issue de 18 instituts et 9 pays en Europe et aux Etats-Unis.
Parmi les institutions représentées figurent l’Institut Paul Scherer pour la Suisse, l’Institut californien de Technologie et plusieurs instituts Max Planck pour l’Allemagne.
L’expérience rassemble des physiciens de l’atmosphère, des physiciens du système solaire, ainsi que des physiciens des particules et des rayons cosmiques.

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative























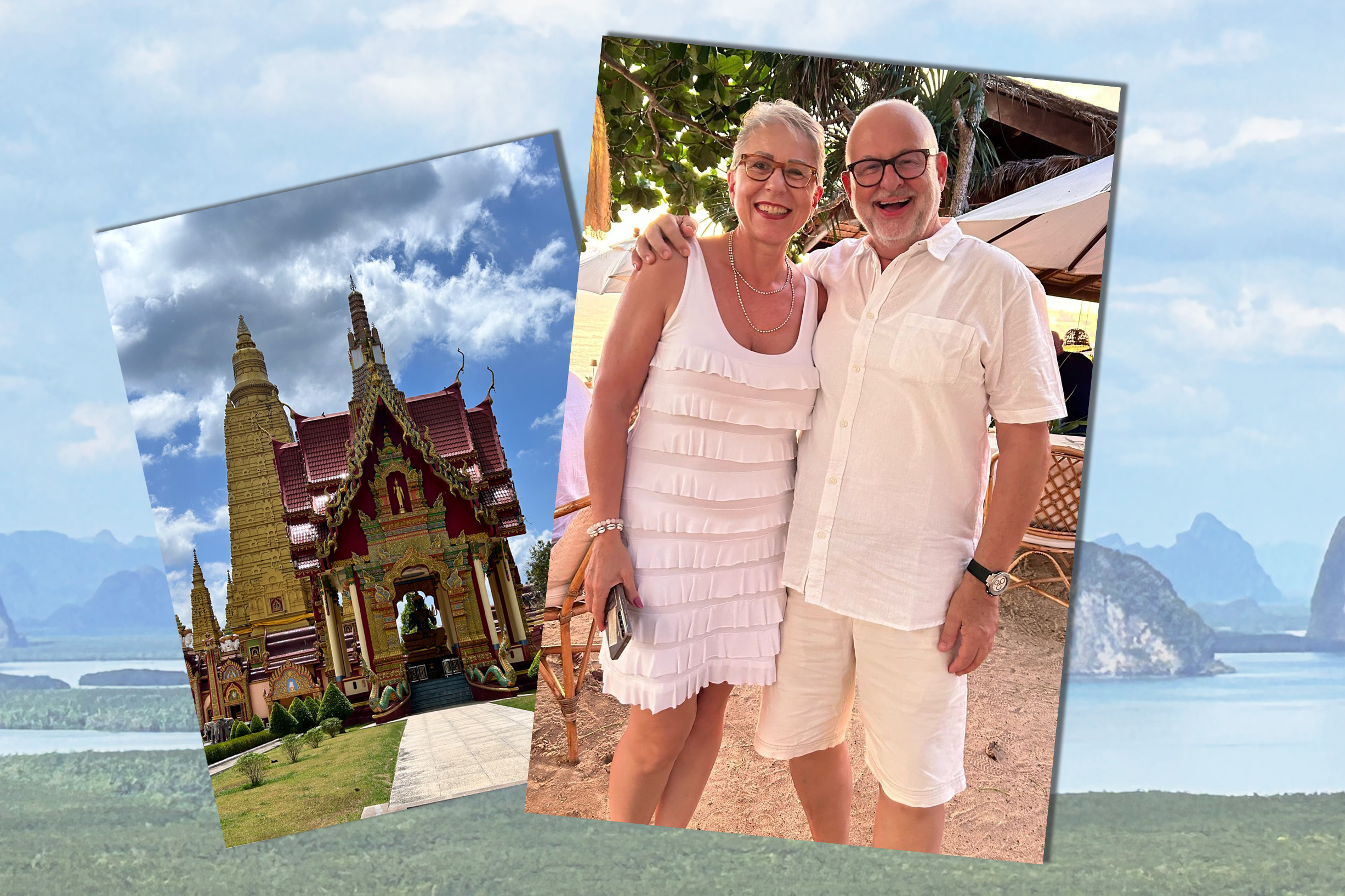









Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.