
Le droit incertain de la guerre

Genève commémore les 25 ans des protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Un droit international humanitaire qui peine à s'imposer.
Cet anniversaire – co-organisé par le CICR et le ministère suisse des Affaires étrangères – tombe à pic. Les attentats du 11 septembre et les ripostes militaires qu’ils suscitent, tout comme le retour de l’option nucléaire tactique, témoignent en effet d’une évolution inquiétante du phénomène guerrier.
C’est en tout cas le point de vue du chercheur français Paul Virilio: «De tout temps, la guerre a suivi des règles et s’est inscrite dans un rapport de force politique».
«Actuellement, la guerre est en train de sortir de ce cadre. Ce qui ouvre la voie à une montée aux extrêmes. A ce titre les attentats du 11 septembre se situent sur le même plan qu’Auschwitz et Hiroshima», souligne encore Paul Virilio.
Banalisation de l’arme atomique
«Ces attentats marquent l’émergence de mouvements qui proclament leur mépris du droit humanitaire. Des groupes qui affirment leur volonté de s’attaquer à des civils et qui considèrent comme cible l’ensemble des ressortissants de tel ou tel pays», s’inquiète de son coté François Bugnion, directeur du droit international au CICR. Un responsable qui s’inquiète également du risque de banalisation de l’arme atomique.
Dans le cadre des célébrations genevoises, une brochette d’experts et de diplomates a d’ailleurs tenté jeudi de prendre la mesure de ces événements et de leurs conséquences sur le droit international humanitaire (DIH).
Ce cadre législatif cherche en effet à limiter la violence des conflits et à protéger ceux qui n’y participent pas. Un cadre qui a évolué par paliers successifs et ce, depuis ses débuts en 1864, lors de la création de la Croix-Rouge.
«Chaque nouvelle étape du DIH a été franchie après une guerre. Il fallait en effet tirer les enseignements de ces événements», relève Luigi Condorelli, professeur de droit international humanitaire à l’université de Genève.
Une guerre de retard
«Ainsi, les Conventions de Genève, poursuit le professeur, ont permis de combler les lacunes béantes du droit humanitaire, suite à la Seconde Guerre mondiale».
De fait, personne ne pouvait prévoir l’holocauste, la création d’armes de destruction massive comme la bombe atomique et la part croissante de civils tués lors d’un conflit. Ce qui fait dire à Luigi Condorelli: «C’est l’un des problèmes du DIH: il arrive souvent avec une guerre de retard».
Les protocoles additionnels de 1977 ont ainsi tenté de cadrer les guerres internes issues de la décolonisation. Des conflits qui ont opposé des Etats et des mouvements non étatiques.
Un exercice qui est loin d’être futile, selon le professeur de droit: «Ces différents textes correspondent à des idéaux, mais également à une volonté précise affichées par les Etats signataires. De plus, les Conventions de Genève sont les instruments de droit international les plus largement acceptés par la communauté des Etats».
Absence d’un mécanisme de contrôle
Luigi Condorelli tempère aussitôt: «Mais cette adhésion s’effrite largement lorsqu’un conflit est déclenché». Conscients du problème, plusieurs gouvernements ont bien tenté d’y remédier, lors des négociations sur les protocoles additionnels, mais sans succès.
«Il manque toujours un mécanisme permettant de vérifier le respect de ces règles. Un respect qui est très largement abandonné au bon vouloir des parties au conflit», souligne Luigi Condorelli.
Seule lueur d’espoir: la Cour internationale de justice en gestation et les tribunaux ad hoc sur le Rwanda et l’ex-Yougoslavie. «Ce sont les seuls mécanismes de mise en œuvre du droit international humanitaire», estime Luigi Condorelli.
Pourtant François Bugnion reste convaincu de l’utilité du DIH: «Le CICR est persuadé que les Conventions de Genève et leurs protocoles additionnels ont permis de maintenir des barrières à la marche vers l’horreur.
Luigi Condorelli souligne de son coté: «Le droit humanitaire intervient quand tout le reste a échoué. C’est un signal d’alarme».
swissinfo/Frédéric Burnand à Genève

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative













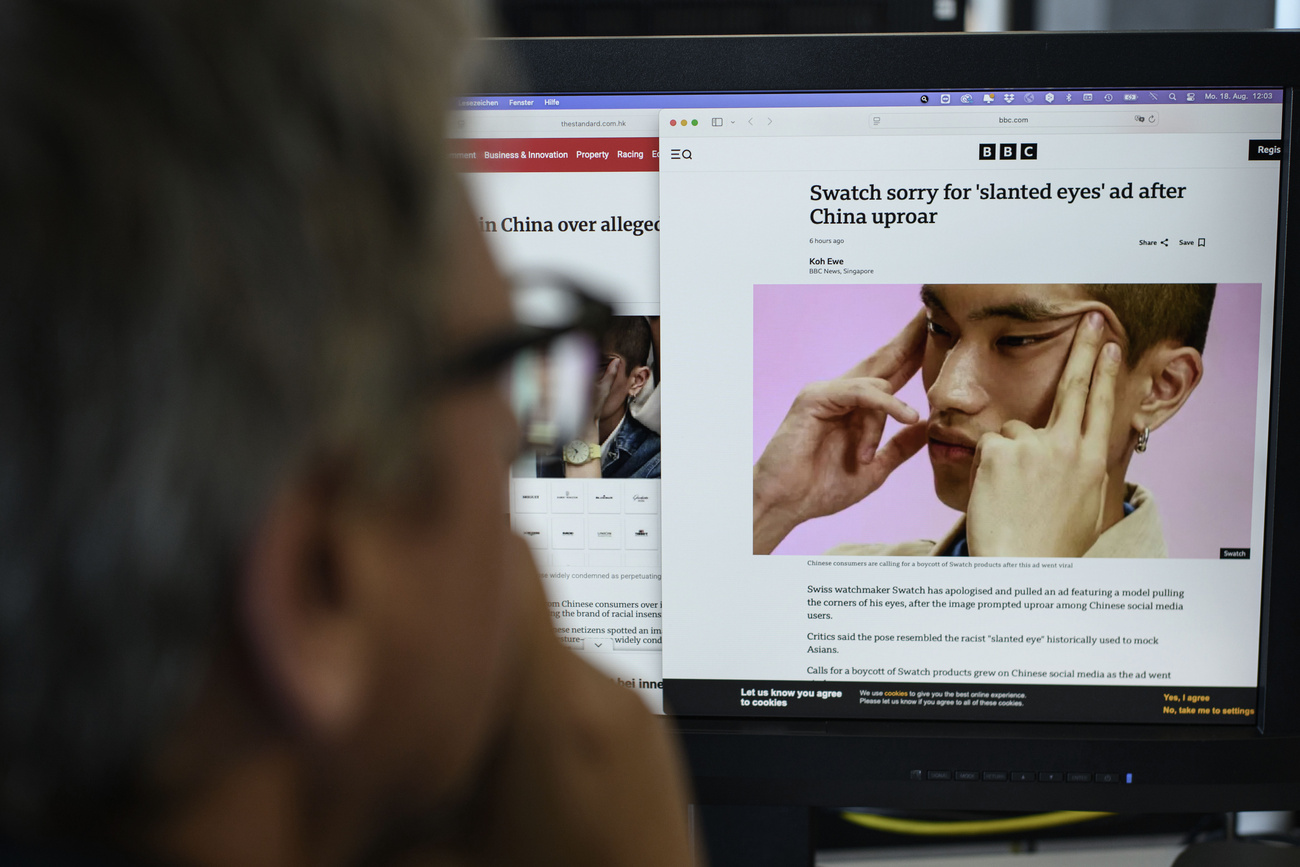




















Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.