
250 décideurs pour repenser une stabilité mondiale

Comment coordonner dans des pays en crise aiguë, sécurité, développement et paix ? C'est sur cette question que représentants de l'ONU, de l'OCDE, de la Banque mondiale et de l'OTAN ont travaillé à Genève. Interview du colonel suisse Urs Gerber.
La Suisse a réuni cette semaine à Genève 250 experts du monde entier pour repenser la paix dans les régions les plus fragiles de la planète. «Cela concerne 1,2 milliard de personnes vivant dans une cinquantaine de pays instables, où les structures ne fonctionnent pas», expliquait jeudi Martin Dahinden, patron de la DDC, l’agence publique suisse de coopération au développement.
Le défi est d’autant plus important que de nombreuses analyses montrent que la crise financière aura des effets catastrophiques dans les pays les plus pauvres si des mesures ne sont pas prises dès maintenant.
Des représentants de ministères de 40 pays ont débattu avec des responsables de l’ONU, de l’OCDE (Organisation de développement et de coopération économiques), de la Banque mondiale et de l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord).
Tout est question de bon dosage entre sécurité, développement et diplomatie, explique le colonel Urs Gerber, responsable des relations internationales dans les forces armées suisses.
swissinfo: La conférence prône l’étroite coordination entre militaires et acteurs du développement et de l’humanitaire. Des alliances décriées comme «contre nature» par les humanitaires…
Urs Gerber: En principe, dans des interventions pour la paix, humanitaires et militaires partagent plus ou moins la même finalité, mais les approches diffèrent.
Il est clair que les organisations humanitaires – dont la nature est de rester indépendantes des agendas politiques – ne veulent pas être directement impliquées avec les militaires – qui sont étroitement liés à leurs gouvernements. Elles considèrent, à juste titre, qu’à partir du moment où elles sont «protégées», elles font part de cette alliance, avec des conséquences négatives évidentes.
Le CICR, par exemple, ne veut pas de formations militaires pour accompagner ses convois de riz ou autres, par crainte de compromettre son image de neutralité. En revanche, une présence militaire à distance peut constituer une protection indirecte lorsque la situation se dégrade à l’extrême, et qu’elle peut s’avérer aussi dangereuse pour ces humanitaires.
swissinfo: Les interventions militaires contre le terrorisme en Afghanistan ont eu des conséquences dramatiques. Comment aurait-on pu faire ?
U.G.: L’Afghanistan illustre bien les défis à résoudre lors de guerres contre le terrorisme suite aux attaques du 11 septembre 2001. Il y a eu deux opérations militaires simultanées, l’une avec le mandat de l’ONU, l’autre menées par les forces américaines, pour éradiquer les structures d’Al Qaïda et des Taliban dans ce pays.
Très rapidement, les effets collatéraux sont apparus, avec le même problème qu’en Iraq.
Dans ce cas, comme en Iraq, on a dissocié l’intervention militaire du reste. Alors qu’il faut préparer en amont l’intervention militaire avec tous les acteurs, humanitaires, du développement, financiers et politiques. C’est cette idée qui est véhiculée dans la conférence.
swissinfo: Mais, dans des situations comme celles post 11 septembre 2001, les Etats veulent agir vite. En quoi une telle conférence va les motiver à changer de tactique ?
U.G.: Il est vrai que, pour que la coordination fonctionne, il faut la confiance entre les personnes sur le terrain. Ensuite, c’est avec le résultat que l’on peut convaincre les décideurs.
Mais on ne peut pas seulement agir de bas en haut. Il faut un effet yoyo pour faire avancer les choses. De temps en temps, il faut des séances de haut niveau avec les décideurs pour les sensibiliser à une nouvelle approche. De telles conférences permettent d’enclencher un processus de réflexion. Si l’on n’agit qu’en bas de l’échelle, on perd du temps. Car, malheureusement, ce ne sont pas les gens du terrain qui vont pouvoir influencer les décideurs à Paris, Berne ou Washington.
swissinfo: Pourquoi la Suisse est-elle motivée à organiser une telle conférence ?
U.G.: La globalisation a clairement démontré que, même si notre pays est petit, il ne peut pas se retrancher dans ses frontières sans se sentir concerné par le monde. La moitié de nos francs suisses sont gagnés à l’étranger, dans tous les coins de la planète. La Suisse a un intérêt direct à s’engager à maintenir la stabilité dans le monde.
La Suisse n’est pas au volant de la voiture qui roule, mais elle essaye d’être un passager. Nous ne sommes pas membres d’alliances, à part l’ONU. Nous sommes un pays neutre, sans histoire coloniale, c’est notre valeur ajoutée qui nous permet d’être crédibles. Notre présence est perçue comme une sorte de label.
swissinfo: Avez-vous un exemple positif de cette alliance entre défense, développement et diplomatie ?
U.G.: A la demande des autorités du Sud Soudan, le ministère de la Défense helvétique a assisté les forces militaires locales pour permettre aux unités rebelles d’acquérir des standards internationaux.
Il faut relever que la Suisse avait préalablement joué un rôle primordial dans un autre accord de paix au Soudan. Les autorités du Sud Soudan se sont alors adressés aux diplomates suisses pour faire leur demande. Ce détail est important car l’initiative n’est pas venue de la Défense, mais des Soudanais eux-mêmes, qui ont passé par les canaux diplomatiques.
Cet exemple illustre bien l’importance de cette étroite collaboration. D’ailleurs dans le Sud Soudan, nous allons même construire une maison suisse réunissant tous les efforts étatiques de la Suisse.
swissinfo: interview Carole Vann/InfoSud
Pour les experts de la conférence dite 3C («cohérence, coordination, complémentarité»), l’aide au développement va être directement touchée par la crise économique. Selon le PNUD, les ressources disponibles devraient diminuer d’au moins cinq milliards de dollars.
«Nous allons vers des temps plus difficiles en raison de restrictions budgétaires chez la plupart des pays donateurs. Des recettes fiscales en baisse pourraient affecter l’aide au développement et humanitaire», a déclaré Martin Dahinden. Et de rappeler que les pays donateurs se sont engagés, dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à porter leur aide à 0,7% de leur PNB d’ici 2015.
«Les prix des matières premières et le rapatriement de fonds des immigrés sont en baisse en même temps que les flux d’investissements privés dans les pays pauvres», a relevé Alastair McKechnie, directeur à la Banque mondiale.

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative













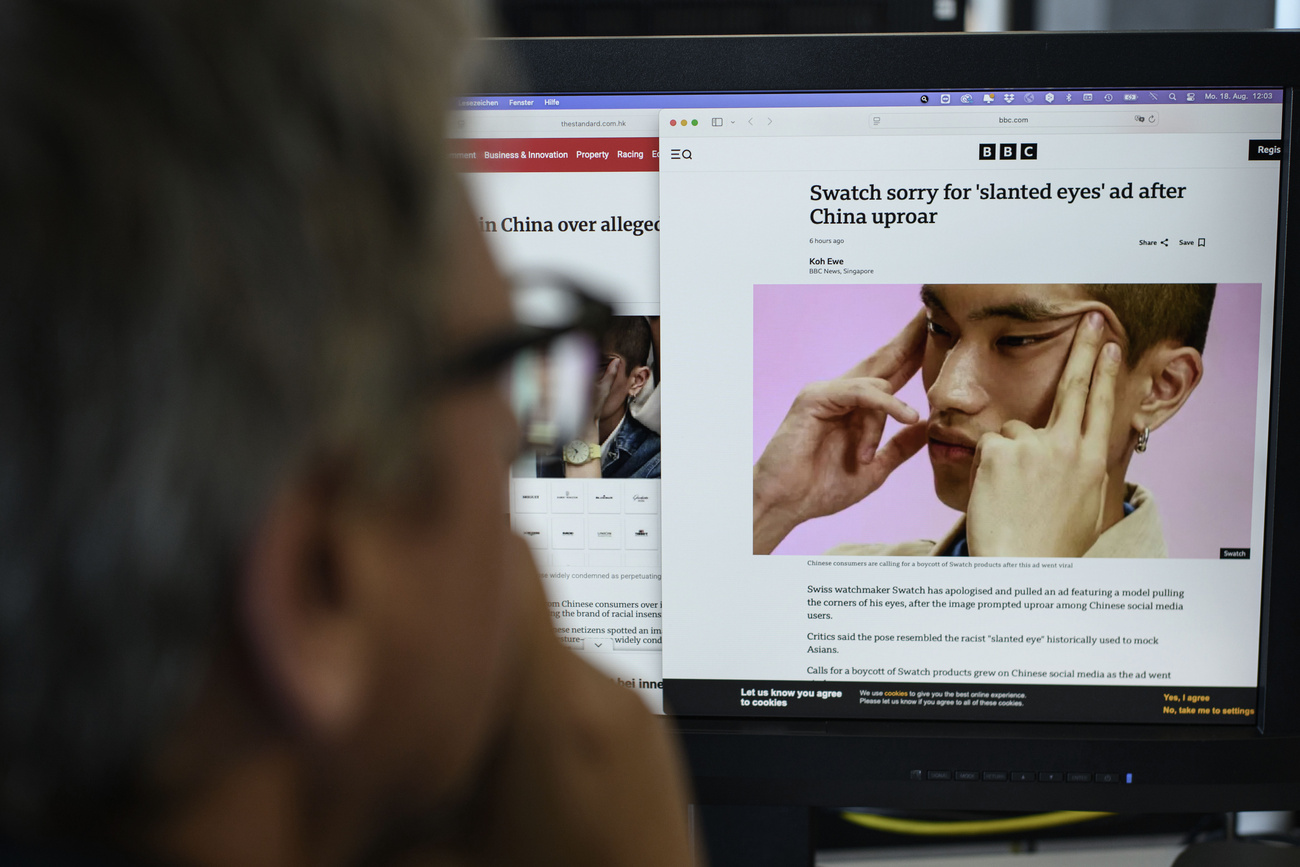






















Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.