
Les Genevois ne veulent pas perdre leur latin

Une véritable mobilisation populaire a convaincu le gouvernement genevois de revenir en arrière: la présence du latin dans les programmes scolaires ne sera pas diminuée. Mais pourquoi étudier cette langue morte est-il encore considéré comme important? La réponse de spécialistes.
Pas moins de 17’003 signatures en un mois et demi: c’est le résultat des efforts des professeurs de latin de Genève qui se sont insurgés contre la proposition du gouvernement cantonal de supprimer cette matière des programmes de cycle d’orientation (élèves de 13 ans).
Le comité qui a mis sur pied la pétition a aussi récolté des signatures hors des frontières cantonales. Grâce à une campagne active menée sur Internet et sur Facebook, les paraphes sont arrivés même de Suisse alémanique et du Tessin. Le résultat inespéré du mouvement – les promoteurs visaient 10’000 signatures – a donc convaincu le gouvernement de modifier son projet.
«Nous avons été les premiers surpris par ce résultat, admet Claude Antonioli, professeur de latin au lycée Rousseau de Genève. Nous nous sommes rendus compte que, pour beaucoup de personnes, le latin était comme l’or, une valeur-refuge. Une partie importante de la population estime en effet que cette langue reste un point de référence.»
Gymnastique intellectuelle
«Plus qu’une langue morte, le latin est considéré comme une langue mère, ajoute Andrea Jahn, vice-président de l’Association suisse des philologues classiques et professeur de latin au lycée de Lugano. En l’étudiant, l’élève acquière une perspective historique, culturelle et, en même temps, par exemple dans le cas de l’italien, réussit à mieux comprendre les bases linguistiques et grammaticales de sa propre langue.»
Et Andrea Jahn de rappeler que «dans un monde comme le nôtre, caractérisé par des exigences de type technique et économique, s’occuper de manière approfondie de la traduction contribue certainement à améliorer la maîtrise de la langue d’arrivée».
«Le grand mérite de l’étude de langues antiques comme la latin et le grec, c’est le côté… aventure, estime Claude Antonioli. Se pencher sur elles signifie en effet s’interroger continuellement sur le sens d’un mot, sur sa position dans la phrase, sur la meilleure traduction. La personne est donc obligée de prendre sans cesse des décisions, ce qui représente un avantage certain dans le parcours de formation. Il ne s’agit donc pas d’une bataille pour imposer une vision passéiste de l’école.»
Unique désavantage: «Il s’agit clairement d’un processus fastidieux dont les résultats ne sont pas immédiats; il faut plusieurs années de préparation pour traduire Tacite», ajoute-t-il.
Un snobisme culturel
Mais tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Professeur de didactique à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, Elsbeth Stern exprime depuis plusieurs années déjà des réflexions critiques par rapport à l’étude de cette langue. Sur la base de ses recherches, elle met fortement en doute l’avantage réel conféré par le latin pour l’apprentissage des langues modernes et pour le développement d’une pensée logique. D’après elle, il serait nettement plus important d’investir les ressources dans l’enseignement des sciences exactes, par exemple les mathématiques.
Par ailleurs, dans une récente interview, Elsbeth Stern a affirmé: «Le fait d’avoir étudié le latin fournit sur un candidat à un poste de travail une information qui n’apporte pas grand-chose de plus que la couleur de ses cheveux». Pour cette spécialiste de la didactique, se féliciter de la présence du latin dans un curriculum vitae est dépassé au niveau international et dénote un certain snobisme culturel.
Pour Andrea Jahn, en revanche, «le latin est une matière qui éduque à la rigueur, à la constance et à la formation de la pensée. Il s’agit de qualités certainement appréciées sur les marché du travail actuel, même si, évidemment, le latin ne constitue par l’unique critère pour l’attribution d’un poste de travail.»
D’un autre côté, «d’autres études montrent au contraire que celui qui a étudié le latin ou le grec obtient ensuite de meilleurs résultats que ceux qui n’ont été ni latinistes ni hellénistes», objecte Claude Antonioli.
Par rapport au concept d’utilité, Andrea Jahn fait l’observation suivante: «Cela dépend beaucoup de la manière dont nous définissons ce qui est ‘utile’. Je suis convaincu qu’en enseignant des matières ‘inutiles’, comme les langues antiques, la littérature ou les arts, on transmet une connaissance et une discipline qui se révèleront précieuses également dans un monde moderne, technologique et productif. Evidemment, ceci vaut aussi pour d’autres matières telles que, justement, les mathématiques. Il ne s’agit pas de déterminer laquelle est la plus utile.»
Une chance pour tous
Les professeurs de latin refusent absolument l’étiquette de matière élitaire. «De nos jours, l’étude des langues antiques ne représente plus une qualité requise par une classe sociale. Il est en effet fondamental que la possibilité de suivre cet enseignement soit offert à tous les étudiants», affirme Andrea Jahn.
«Ce que nous avons défendu et que nous défendons n’est certainement pas un privilège de classe, mais bien la chance pour tous les élèves de penser dans une dimension différente, où ils peuvent se prendre un peu plus de temps pour cogiter», conclut Claude Antonioli.
Il n’existe pas en Suisse de données détaillées au niveau national sur les étudiants en latin.
En effet, les réformes scolaires cantonales et nationales des dernières années ont rendu difficile l’évaluation globale du nombre d’étudiants. On estime toutefois qu’environ 10% des maturités englobe le latin comme branche.
Au niveau international, 41% des élèves des écoles supérieures italiennes étudient le latin, ce qui est le record mondial. Ce taux est de 25% en Grèce, 1,3% aux Etats-Unis, 3% en France, entre 5 et 8% en Grande-Bretagne et entre 1 et 2% en Allemagne. Il convient toutefois de remarquer que l’étude du latin est facultative dans la plupart de ces pays, sauf en Grèce et en Italie.
L’examen de latin Latinum Helveticum est proposé par la Commission suisse de maturité et est reconnu par les universités suisses pour l’admission à toutes les filières d’études où le latin est exigé.
L’épreuve écrite dure trois heures et consiste en la traduction d’un texte d’environ 180 mots tiré de l’œuvre de Cicéron, Salluste, Tite Live ou Sénèque.
L’épreuve orale dure 15 minutes et consiste en la traduction explicative d’une quinzaine de vers tirés d’un corpus d’au moins 400 vers de Virgile, Horace ou Ovide.
Traduction de l’italien: Olivier Pauchard

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
















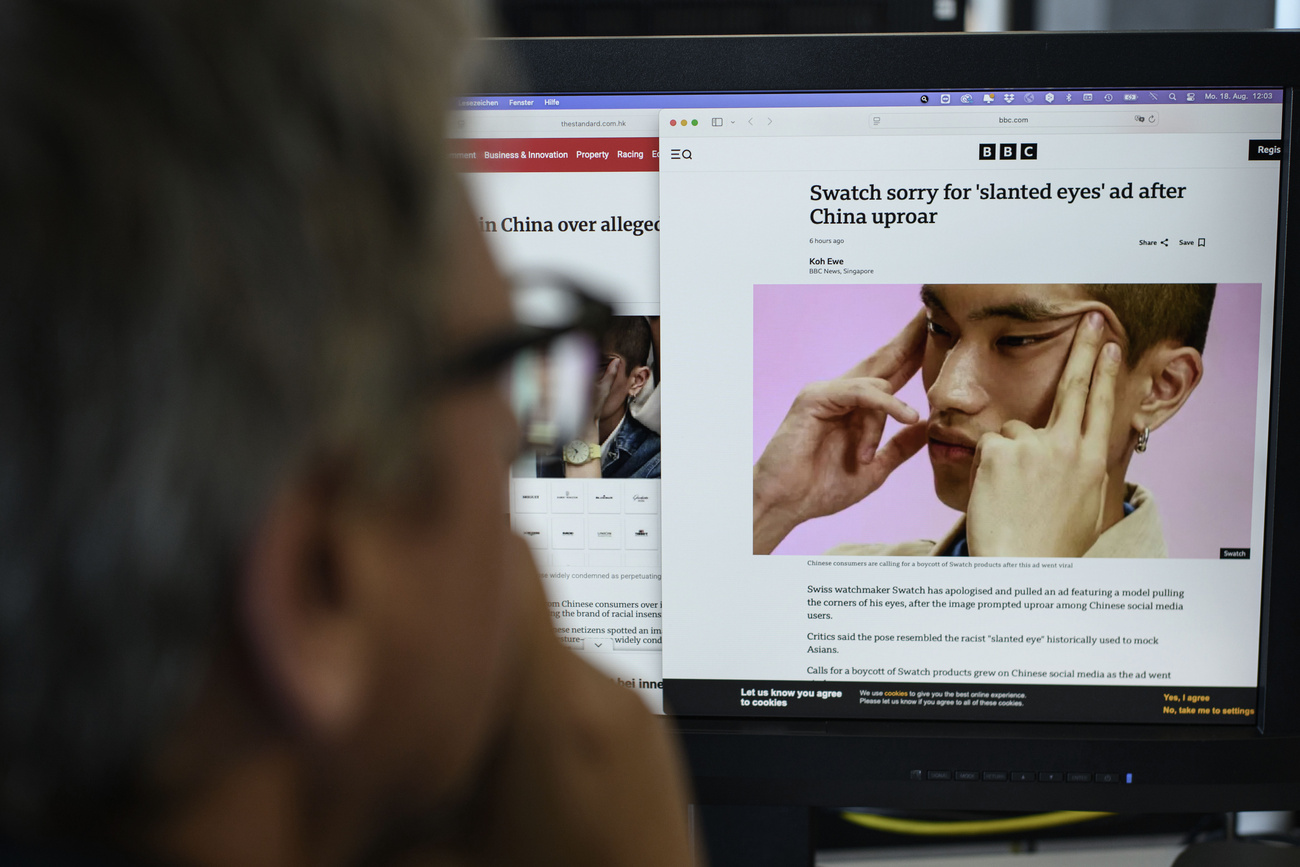



















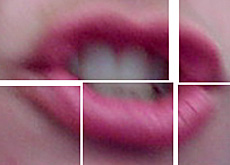

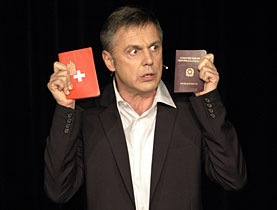
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.