
L’humain, du caca à l’Au-delà

Les Journées de Soleure se poursuivent. Parmi les innombrables films, on peut choisir, ou se laisser guider...
En une projection de quatre films, passer par exemple de la défécation à la ‘décorporation’ en passant par Jean Rouch ou la pédophilie. Survol.
Ciel gris et bas, un jour de semaine. Il est midi. L’heure d’aller manger. Ou de passer sur sa faim et de s’enfiler dans un cinéma, qui annonce un programme de quatre films. Le menu sera donc tout de même copieux.
En guise d’apéritif, un court-métrage au titre sibyllin: «U», à prononcer «you». La réalisatrice est présente: Yuri A, s’appelle-t-elle. Petite bonne femme apparemment timide, de type asiatique, elle est née à Sao Paulo, puis est passée par les USA et le Japon avant de voir produit son film à Zurich.
Son film, donc. En quatre minutes, une dissertation sur l’art de la défécation et du prout. Dit comme cela, c’est un peu brutal. Pourtant, c’est bien de cela qu’il s’agit. Sur fond de couleurs pétantes, c’est le cas de le dire, avec des enfants en guise de figurants, l’affaire est rondement menée, scatologique et joviale à la fois. Etonnant.
L’Homme et son musée
L’Homme avec un grand H avait son musée à Paris. Mais le Quai Branly va entraîner le démantèlement du Musée de l’Homme, au Palais de Chaillot. Alors Dominique de Rivaz et Lionel Baier on braqué caméra et micro en direction de Jean Rouch, l’ethnologue et le cinéaste. Et cela donne «Mon père, c’est un lion (Jean Rouch pour mémoire)».
Dans la salle de projection du Musée, il se souvient. De Godard et de Truffaut, tentant d’apprendre leur métier au même endroit il y a longtemps. Ou de son père, ce lion. Ou de sa propre communion, en Algérie, et surtout, de son habit trop étroit qui l’a alors empêché de voir passer Jésus ou Dieu. Lui, Jean Rouch, ce qu’il sacralise, c’est plutôt le cinéma.
Jean Rouch, goguenard et néanmoins ulcéré par la mort de son musée, qui entonne «Le chant des Partisans» et déclare ensuite: «C’est ça, le Musée de l’Homme!» Etonnant, aussi.
L’homme et sa part d’ombre
Du documentaire, on commute soudain sur la fiction. Avec un premier film cette fois-ci, également court-métrage, de Jean-Cyril Rossier.
Dans un bar, une jeune femme, dure, tendue. Rencontre avec un homme, intrigué. Dans des lumières soignées et grâce à une structure en flash-back, Jean-Cyril Rossier va nous faire remonter le fil de la vie de Leila et nous amener à découvrir sa blessure: les abus sexuels qu’enfant, elle a vécus. Alors il y a ce pistolet qu’elle ne sait pas contre qui braquer, le bourreau ou la victime.
De bonnes intentions, un sens certain du récit, mais quelques maladresses aussi, comme le jeu de certains acteurs ou une conclusion un peu gentillette.
L’homme et son mystère
Retour au documentaire avec Denise Gilliand et un film intitulé «Aux frontières de la mort». «Faire un film sur la mort, ce n’est pas tout simple. C’est intéressant à étudier, mais difficile à filmer» déclare la réalisatrice au public. On la croit volontiers.
Et pourtant son travail, produit par le magazine «Temps présent» (TSR) est riche et réussi. D’abord par le choix des témoins, ceux qui ont frôlé le grand saut – noyade, accident – et qui ont vécu ces fameuses NDE («Near Death Experience»). ‘Décorporation’, attirance vers une lumière de plus en plus forte, de plus en plus enveloppante, puis sentiment de compréhension et de bonheur infinis.
Ensuite par le choix d’un répondant scientifique, une femme qui ne joue ni l’intransigeance réfractaire, ni la complicité facile.
Elle a compris que les mots «tunnel», «lumière», «ange», ne sont que des mots, des mots maladroits qui tentent de raconter un vécu indicible, car «notre vocabulaire n’est pas fait pour rendre compte de ça».
La plupart des témoins sont désormais convaincus de l’existence d’une troisième dimension, d’une vie après la mort, ou de l’existence de Dieu, au choix. Alors, même si l’on évacue la dimension spirituelle de l’affaire, on est obligé de prendre en compte la multiplicité des cas et la coïncidence des témoignages.
Mais, rationaliste, on se rappelle soudain que lorsqu’on se lève trop brusquement, il arrive à chacun d’entre nous de voir des petits papillons noirs. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu’on a momentanément vécu parmi les lépidoptères.
D’ailleurs, on se lève. Il est 13 heures 40, la séance est terminée. Dehors, le ciel est toujours gris. On ne peut s’empêcher, tout de même, un instant, de l’observer avec un autre regard.
swissinfo, Bernard Léchot, Soleure

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

























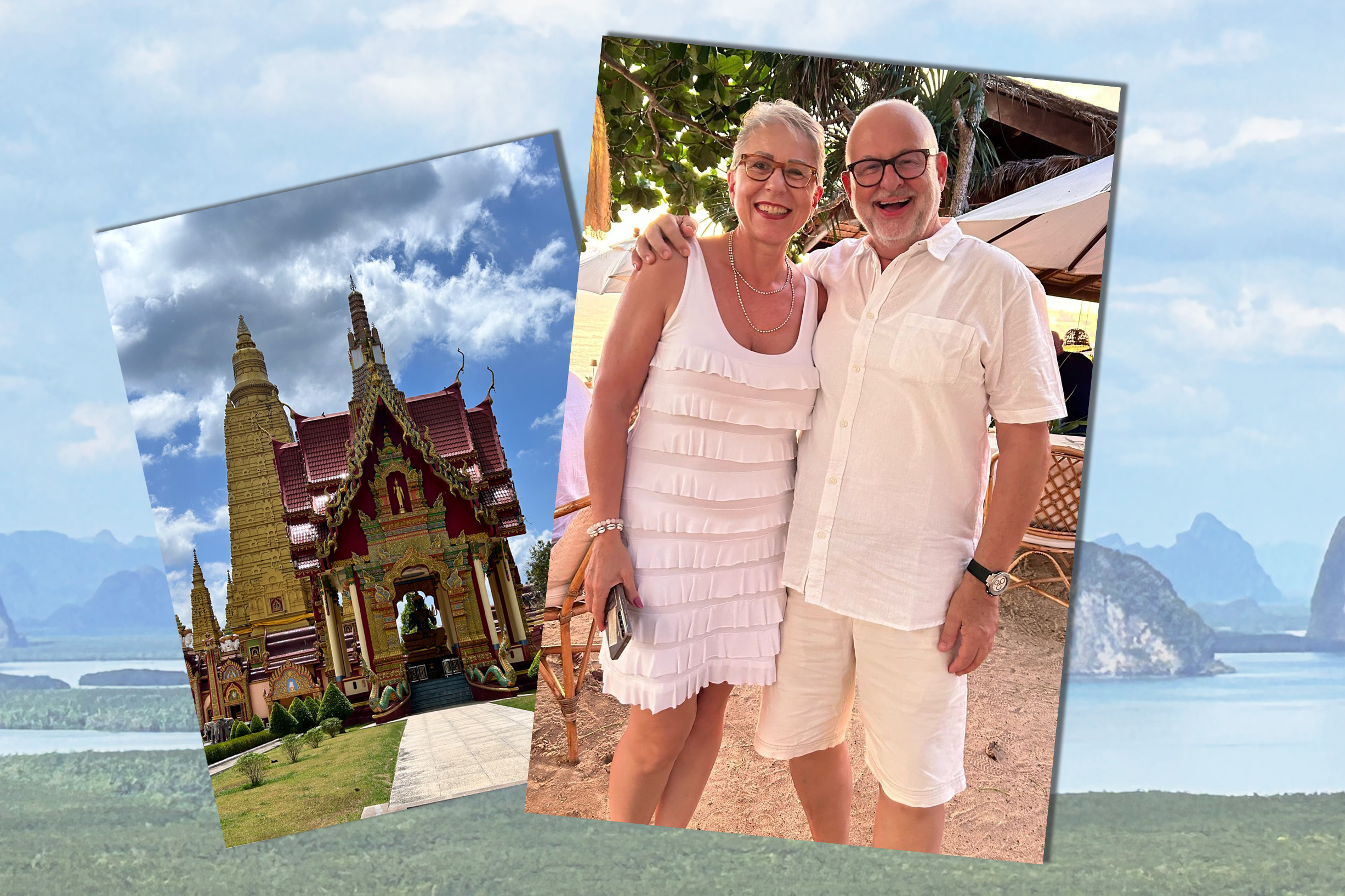







Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.