
Comment les preuves numériques remodèlent les enquêtes de l’ONU sur le Myanmar

Les enquêteurs de l'ONU utilisent des preuves numériques pour documenter les crimes de guerre commis au Myanmar, allant de la torture aux frappes aériennes, mais la diminution des fonds menace leur travail.
Nicholas Koumjian a consacré sa carrière à tenter d’obtenir justice en Bosnie, en Sierra Leone, au Timor-Leste et au Cambodge. Depuis Genève, il souligne combien le Myanmar constitue un cas à part.
Il l’explique notamment par le volume de preuves numériques des crimes commis à l’encontre des Rohingyas, minorité musulmane persécutée depuis des années dans ce pays majoritairement bouddhiste. Depuis 2016 et le lancement de brutales «opérations de déblaiement» visant leur communauté, 720’000 personnes ont été forcées de fuir.
«L’une des grandes différences [par rapport aux autres pays] est tout simplement due à la technologie», indique Nicholas Koumjian. «Même s’ils étaient très pauvres, les Rohingyas avaient tous un téléphone. Nous avons recueilli des milliers de vidéos qu’ils ont filmées alors que leurs villages étaient en train d’être incendiés.»
C’est notamment sur ces atrocités que se concentre le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar (IIMM)Lien externe que dirige Nicholas Koumjian. Créé en 2018 par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, l’IIMM a pour mission de recueillir et de conserver des preuves des crimes internationaux les plus graves commis dans le pays de l’Asie du Sud-Est depuis 2011.
Pour l’enquêteur, le déluge de vidéos filmées par portable et de publications sur les réseaux sociaux, par des survivants de crimes passés et en cours, illustre à la fois la promesse et le fardeau de ce travail: la masse d’éléments numériques offre un accès sans précédent et en temps réel aux preuves, mais il faut aussi les trier, les authentifier, les stocker et les traduire. «La quantité de matériel que nous obtenons, qui vient en grande partie des réseaux sociaux, se monte à des millions d’éléments. Et quand je parle d’éléments, cela peut aussi bien être une photographie qu’un rapport de 300 pages», dit-il.

Depuis 2020, l’unité spécialisée dans les enquêtes open source (accès libre) est devenue indispensable. Ses détectives numériques écument le web à la recherche de vidéos, d’images et de messages avant de les replacer avec précision dans le temps et l’espace grâce à des outils de localisation temporelle et de géolocalisation.
L’équipe suit également les déclarations en ligne révélant les intentions ou les responsabilités de commandement et traque les traces numériques de ceux qui alimentent les discours de haine contre les Rohingyas.
Ce travail minutieux transforme des pixels éparpillés en preuves admissibles devant les tribunaux. «Quand une vidéo montrant des prisonniers capturés en train d’être exécutés circule sur les réseaux sociaux, ce qui s’est produit plusieurs fois, [l’unité] peut faire beaucoup de choses. Elle peut remonter à la première apparition sur les réseaux, identifier les sources et poursuivre ses investigations.»
L’intelligence artificielle pourrait bientôt remodeler, et accélérer, la quête de justice. «Nous pourrons même faire des recherches en n’utilisant que l’IA, par exemple en lui demandant ‘Montre-moi toutes les preuves qui mentionnent cette personne’, mais aussi en lui posant des questions plus complexes», illustre Nicholas Koumjian.
L’une des principales activités de l’unité open source est de contrôler et d’authentifier les vidéos et photographies pour déterminer s’il s’agit de vraies images ou de deepfakes. Mais le développement technologique de l’IA annonce de nouveaux défis: «distinguer entre ce qui est vrai et les fake news va devenir de plus en plus difficile.»
Au final, la technologie ne peut pas tout résoudre. Contrairement à la Bosnie, où l’OTAN a fait appliquer les ordonnances des tribunaux, l’IIMM n’a pas accès au Myanmar et doit entièrement travailler depuis l’étranger, souligne son chef.
Par ailleurs, contrairement aux conflits qui opposent deux camps bien définis, la guerre au Myanmar implique une multitude d’acteurs. L’armée, les milices et les groupes d’opposition armés sont tous accusés de crimes, et chaque groupe génère son propre corpus de preuves.

Les crimes commis en détention: une voie vers la condamnation
Avec tant d’atrocités sur lesquelles enquêter, l’IIMM doit jauger les priorités. Parce qu’ils donnent souvent les pistes les plus claires, les crimes commis en détention sont devenus un objectif central, comme le souligne le dernier rapport annuel du Mécanisme.
«Les gens connaissent souvent, ou en tout cas peuvent identifier, la personne qui les a torturés, eux ou une tierce personne, dans la prison où ils étaient incarcérés. Les détenus connaissent souvent le commandant de la prison ou les interrogateurs. Ou alors, nous avons accès à des documents qui montrent qui était alors en charge de la prison», indique Nicholas Koumjian.
Les témoignages recueillis font état de chocs électriques, de passages à tabac, de strangulations, de brûlures et de viols collectifs, notamment dans les sites de détention informels. Ces sites, qui échappent à tout contrôle externe, sont souvent les plus abusifs: les interrogateurs y font pression pour obtenir de faux aveux et les femmes sont constamment confrontées à des menaces de violences sexuelles, «en tout cas la menace implicite que si elles refusent de coopérer, elles subiront une forme d’abus sexuel».
Les violences sexuelles sont une caractéristique de longue date des opérations de l’armée. Elles ont été systématiques lors des campagnes dites «de déblaiement» en 2016-2017. Leur ampleur constitue «peut-être le pire» de ce que Nicholas Koumjian a vu dans tous ces conflits. Les témoignages des survivantes ont été corroborés par les enquêteurs lors d’entretiens avec des travailleurs de la santé ayant traité des blessures génitales, des grossesses résultant de viols et des demandes d’avortements.

Documenter de tels crimes à distance reste une tâche ardue. Pour des raisons de sécurité, de nombreux entretiens sont menés à distance, souvent avec l’aide de groupes de la société civile locale qui établissent le premier contact avec les témoins.
Lorsque c’est possible, l’IIMM oriente les survivants vers un soutien psychologique. Mais, note le responsable, le fonds alloué au soutien psychosocial ainsi qu’à la protection des témoins, qui passe dans de rares cas par leur relocalisation, est épuisé. «Nous n’avons pas d’argent pour cela en ce moment.»
Lier les atrocités aux hauts gradés
En fin de compte, les procureurs doivent non seulement prouver que des atrocités ont eu lieu, mais que la responsabilité incombe aux rangs les plus hauts. Ce lien est le plus difficile à établir.
«Le plus compliqué à démontrer, c’est pourquoi cette personne haut placée est responsable d’un crime dans un village où elle n’a peut-être jamais mis les pieds, ou qui a été commis envers une femme et sa famille qu’elle n’a jamais rencontrées, par quelqu’un avec qui elle n’a jamais parlé», explique Nicholas Koumjian. «Il s’agit ici de recueillir les preuves qui montrent que la personne haut placée savait, les lignes de conduite qu’elle a autorisées [et] les divers ordres qu’elle a donnés.»
De précédents tribunaux ont montré que cela pouvait être fait. Charles Taylor, président du Liberia de 1997 à 2003, a été condamné pour crimes de guerre pour avoir aidé les rebelles lors de la guerre civile sierra-léonaise. Au Cambodge, les hauts dirigeants des Khmers rouges ont été tenus responsables des crimes qu’ils n’ont jamais directement commis, mais qu’ils ont ordonnés ou permis.
Les preuves rassemblées par l’IIMM ont déjà alimenté la requête de mandat d’arrêt émise par la Cour pénale internationale contre le commandant en chef Min Aung Hlaing, qui dirige le Myanmar depuis 2021. Avec 24 autres personnes, il fait également l’objet d’un mandat d’arrêt émis par le Tribunal pénal fédéral d’Argentine.

Mais rendre justice prendra du temps. Les condamnations du tribunal cambodgien des Khmers rouges sont intervenues quatre décennies après les crimes. «Nous ne voulons pas attendre 40 ans, mais il est très difficile de prédire quand et où la justice pourra être rendue», prévient Nicholas Koumjian.
En attendant, les archives, fortes de 600 témoignages oculaires, de millions de documents, photos, vidéos et images satellites, continuent de s’agrandir. Les déficits de financement menacent cependant les unités spécialisées dans les violences sexuelles, les crimes contre les enfants et le renseignement en libre accès.
Le responsable de l’IIMM insiste sur le fait que ce travail ne concerne pas seulement de futurs procès, mais aussi le présent. «Nous mettons une certaine pression sur ces auteurs potentiels, afin qu’ils puissent être un jour traduits en justice.»
Torture et violences sexuelles en détention – Preuves de coups, de chocs électriques, de strangulations, de viols collectifs et de brûlures des parties génitales, en particulier dans les installations informelles. Les commandants supervisant ces sites ont été identifiés.
Exécutions extrajudiciaires – Perpétrées par les forces armées, les milices affiliées et les groupes armés d’opposition contre des combattants capturés et des informateurs présumés.
Frappes aériennes sur des civils – Visant des écoles, des marchés, des hôpitaux et des mosquées, y compris pendant les opérations de sauvetage suivant le tremblement de terre de mars 2025, en violation manifeste des lois de la guerre.
Ciblage ethnique – Nouvelles enquêtes sur les atrocités dans l’État de Rakhine dans le cadre d’affrontements entre la junte militaire et l’Armée d’Arakan, parallèlement aux travaux toujours en cours sur les crimes commis entre 2016-2017 contre les Rohingyas.
Partage de preuves – Coopération avec la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, l’Argentine et les autorités du Royaume-Uni, contribuant à des mandats d’arrêt internationaux et à des procédures judiciaires.
Relu et vérifié par Virginie Mangin/ traduit de l’anglais par Albertine Bourget

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
























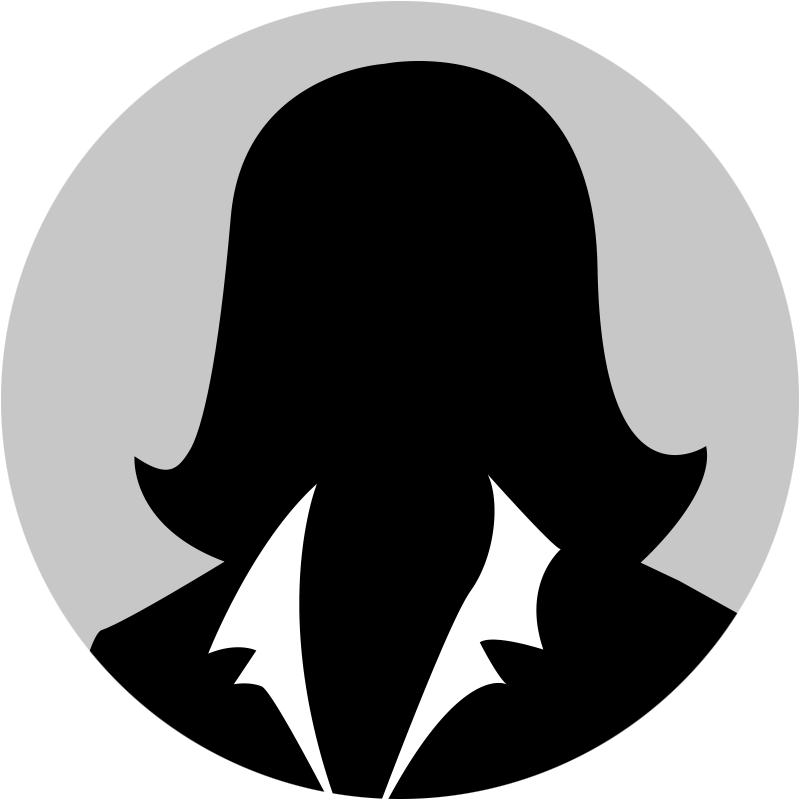
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.