
Quand les souris oublient l’heure du repas

Des chercheurs des universités de Fribourg et de Strasbourg ont accompli un nouveau pas vers la compréhension des mécanismes qui règlent nos différentes horloges internes.
Après modification d’un seul gène, une souris ne manifeste plus aucun signe d’appétit à l’heure où elle devrait manger. Perspectives intéressantes, mais le remède contre l’obésité est encore loin.
Urs Albrecht travaille sur le gène Per 2 (pour Période 2) depuis bientôt dix ans. C’est lors d’un séjour de recherche aux Etats-Unis en 1997 que ce professeur de biochimie de l’Université de Fribourg a identifié ce segment d’ADN, présent dans les chromosomes de la plupart des mammifères.
Per 2 est une pièce importante des horloges internes de l’organisme. «Pour fonctionner de manière optimale, cette grande usine chimique qu’est le corps a besoin d’horaires, explique Urs Albrecht. Ainsi, il est préférable de manger le jour et de se reposer la nuit.»
Pour régler tous ces processus chimiques, le corps a besoin de plusieurs horloges. La principale, localisée dans le cerveau, est synchronisée par la lumière, sur un cycle de 24 heures. Elle nous rend aptes à fonctionner la journée et à dormir la nuit.
Les horloges secondaires sont réparties dans plusieurs organes et obéissent à des signaux différents. Ainsi, l’horloge alimentaire est synchronisée par la prise de nourriture. C’est elle qui nous fait mémoriser l’heure des repas et anticiper le plaisir de manger et le travail de digestion.
Des souris qui refusent de se mettre à table…
Que se passe-t-il si cette horloge se dérègle? Pendant plus de deux ans, l’équipe du professeur Albrecht et celle de son collègue Etienne Challet, de l’Université Louis Pasteur à Strasbourg (France), ont observé le comportement de souris de laboratoire, nourries régulièrement tous les matins à 10 heures.
Très vite, les rongeurs prennent l’habitude de ce repas à heure fixe. Leur horloge alimentaire se règle en conséquence et leurs organismes se préparent à manger. Mais pendant ce temps, un autre groupe de souris, qui ont subi une mutation du gène Per 2, reste totalement passif.
Dans le monde sauvage, cette passivité vaudrait rapidement une condamnation à mort. Le temps que les souris mutantes réalisent qu’elles ont faim – ce qui finit tout de même par arriver, grâce au déclenchements de signaux indépendants de l’horloge alimentaire -, les autres ont tout mangé depuis longtemps.
Cela dit, on peut parfaitement survivre avec un gène Per 2 défectueux. Lorsqu’on leur présente de la nourriture en dehors des heures où les autres se ruent dessus, les souris mutantes mangent normalement. «Elles ont juste perdu la notion du temps», explique Urs Albrecht.
Ces travaux ont fait le mois dernier l’objet d’une publication dans la revue britannique Current Biology. Reste maintenant à déterminer la localisation exacte de cette horloge alimentaire et à mieux comprendre comment elle fonctionne.
…et d’autres qui se mettent à boire
Car son dérèglement n’a pas que des conséquences sur l’appétit. Les travaux précédents de l’équipe d’Urs Albrecht avaient montré que des souris dont on altère le gène Per 2 de manière à leur faire confondre le jour et la nuit voyaient augmenter leur taux de glutamate dans le cerveau.
Or, cette substance est connue pour provoquer l’envie de boire de l’alcool. Mises en présence d’un récipient contenant de l’eau et d’un autre rempli d’eau de vie, ces souris avaient tendance à préférer le second.
Les chercheurs ont pu en déduire que les gens qui travaillent de nuit ou qui subissent un décalage horaire important sont plus exposés que les autres au risque de surconsommation d’alcool. Chez eux, en effet, le dérèglement de l’horloge alimentaire altère le gène Per 2 et provoque l’excès de glutamate.
Pas de recette miracle
Obésité, alcoolisme, toxicomanies: les travaux sur le Per 2 ouvrent à la médecine et à la pharmacologie des perspectives intéressantes dans des domaines où elles sont passablement désarmées. Mais il y a encore très loin de la coupe aux lèvres.
«Tout ce que nous savons, c’est que ce gène a quelque chose à voir avec la faim, mais il n’est pas le seul. Je n’ai pas de recette pour dire aux gens qui souffrent de surpoids ‘faites ceci ou cela avec votre gène Per 2 et vous maigrirez’», explique Urs Albrecht.
Comme toujours en biologie, chaque gène a plusieurs fonctions. C’est notamment la raison pour laquelle ces expériences faites sur des souris seraient impossibles sur l’homme. En altérant un gène, on altérerait automatiquement toutes ses fonctions, et alors… gare aux dégâts !
Comprendre d’abord
«Nous sommes dans la recherche fondamentale, rappelle Urs Albrecht. Il est très important de comprendre ce qu’on fait avant de tester la moindre substance pharmaceutique. Parce qu’autrement, c’est seulement un jeu. On essaie quelque chose et on va voir si on a gagné, si on a fait un six au loto».
Et le professeur fribourgeois de lancer un appel à ceux qui soutiennent l’activité scientifique: selon lui, la recherche fondamentale est trop souvent le parent pauvre de la recherche appliquée. Et l’on a tendance à oublier que la seconde ne pourrait pas exister sans la première.
swissinfo, Marc-André Miserez
Les travaux des équipes des professeurs Albrecht et Challet s’inscrivent typiquement dans le domaine de la recherche fondamentale.
Ce terme recouvre les travaux scientifiques qui n’ont pas de finalité économique directe et qui ne visent qu’au développement de la connaissance. La recherche fondamentale est le plus souvent financée par les pouvoirs publics, par des mécènes ou par des fondations.
On lui oppose la recherche appliquée, financée par les entreprises privées ou par des partenariats public-privé, dont le but est de déboucher sur des dépôts de brevets et des produits ou des procédés commercialisables.
Certains scientifiques refusent cette classification et lui préfèrent les termes de recherche et de développement.
Ainsi, selon Marc Rousset, du Centre national (français) de la recherche scientifique, «rétablir le sens du mot recherche permet de comprendre que la science est à l’origine de toutes les découvertes». Le développement, par contre c’est «l’utilisation de connaissances déjà acquises, et éventuellement l’amélioration d’un procédé sur la base de nouvelles connaissances». Mais de lui «ne naîtront jamais de nouveaux concepts».

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative


























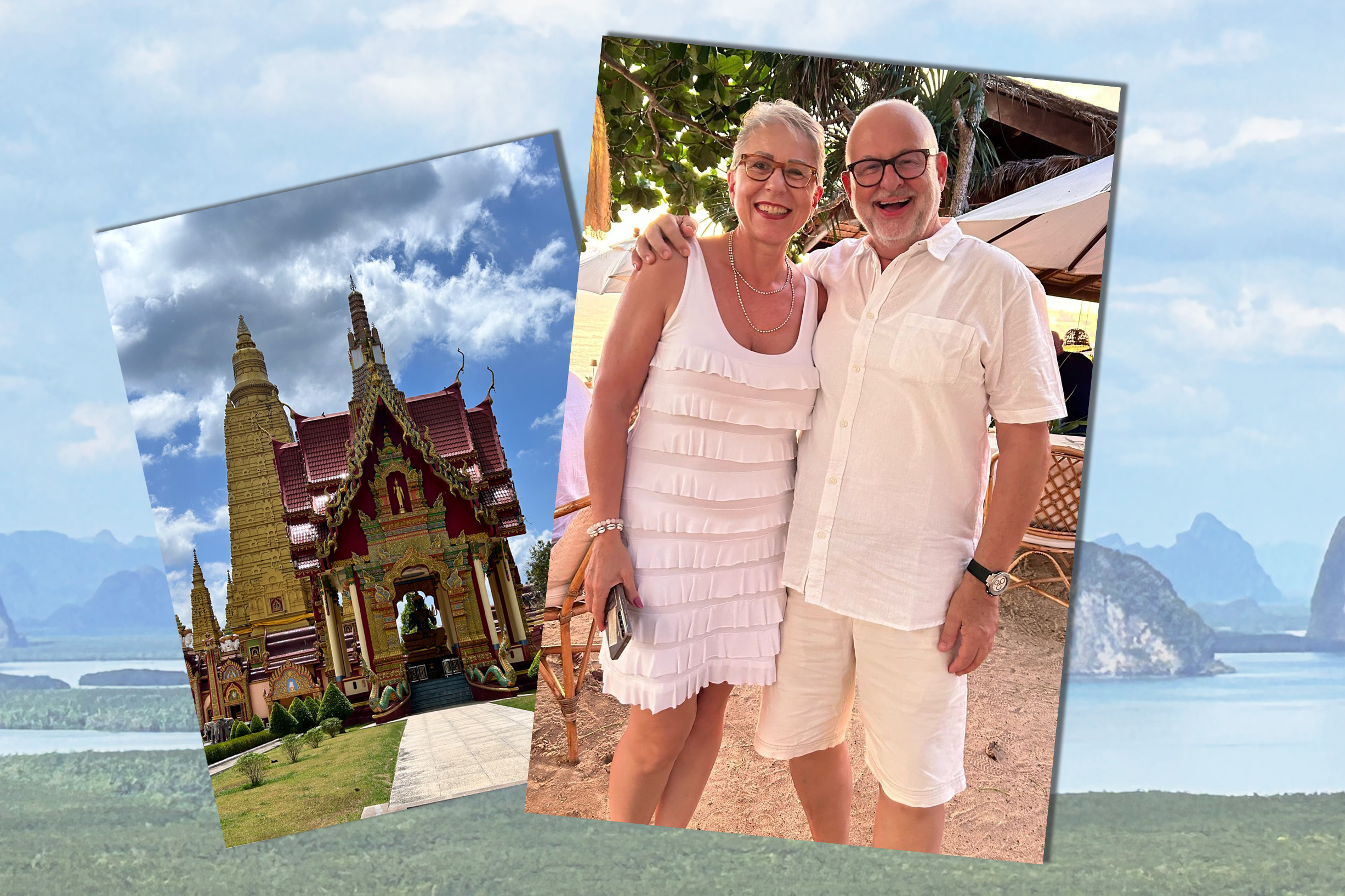







Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.