
Les assemblées communales: le lieu où les Suisses décident de ce qui se passe devant chez eux

Dans de nombreuses communes suisses, ce n’est pas un parlement qui tranche les affaires locales, mais une assemblée de citoyens et de citoyennes. Voici comment ce système fonctionne.
Difficile de faire plusdémocratique que dese réunir pour débattre de questions politiques qui nous concernent directement. «L’assemblée communale est généralement considérée non seulement comme la forme la plus ancienne, mais aussi la plus directe d’organisation démocratique d’une collectivité», explique le politologue Philippe Rochat. L’idée de base est que des personnes égales en droits se rencontrent sur un pied d’égalité.
Cette forme tangible et concrète de démocratie directe est ouverte à près de la moitié des personnes ayant le droit de vote en Suisse. Elles vivent dans l’une des plus de 1650 communes où l’assemblée communale remplace un parlement local élu.
Dans les villages comme dans les villes
Des villages minuscules de quelques dizaines d’habitantes et d’habitants y recourent tout comme la ville de Rapperswil-Jona, qui en compte près de 30’000.
Dans de nombreuses localités, l’invitation à l’assemblée communale est envoyée deux fois par an aux électrices et électeurs, accompagnée de documents comme l’ordre du jour ou le budget.
Lors de l’assemblée, les citoyennes et citoyens se réunissent dans une salle communale ou un gymnase, discutent, votent à main levée ou – si les personnes présentes le demandent – à bulletin secret.
Les pratiques peuvent varier localement: à Horgen, une commune de 22’000 âmes, on vote en se levant. «À Horgen, on assume ses opinions», avait déclaré un ancien président de commune.
Sans engagement bénévole, la démocratie ne fonctionnerait pas en Suisse. Lisez aussi notre article de fond sur le principe de milice:

Plus
Comment le système de milice suisse renforce l’identité – et attire les privilégiés en politique
Town Meetings aux États-Unis et assemblées municipales en Allemagne
Comme la Landsgemeinde du canton de Glaris au niveau cantonal – à laquelle National GeographicLien externe s’est récemment intéressé –, l’assemblée communale fascine au niveau international comme une curiosité du système politique suisse. Mais ce n’est qu’une particularité, pas une exclusivité: dans d’autres pays aussi, les citoyennes et citoyens peuvent décider directement au niveau local.
Le politologue Michael Strebel rappelle qu’en Allemagne, les assemblées communales étaient très répandues après la Seconde Guerre mondiale. La constitution allemande permet encore aujourd’hui de remplacerLien externe un parlement local par une assemblée communale. Et selon l’expert, environ 25 petits villages du Land du Schleswig-Holstein conservent cette forme d’assemblée.
Miachael Strebel voit aussi «certaines similitudes» avec les Town Meetings dans certaines régions des États-Unis. «Il s’agit de réunions citoyennes dans certaines communes américaines où les électeurs et les électrices peuvent se prononcer sur différents aspects de la politique locale – parfois même de manière contraignante», précise-t-il.

Une démocratie où l’on se serre la main
«Que peut apprendre le reste du pays de cela?», demandait en 2024 un reportage de l’agence Associated PressLien externe à propos d’un Town Meeting dans le Vermont. Les gens y disent ce qu’ils pensent, mais à la fin, ils serrent la main de leur voisin.
De même, beaucoup en Suisse voient dans l’assemblée communale un outil de dialogue, donc d’équilibre. Les citoyennes et citoyens peuvent interpeller directement les autorités locales. Les personnes de sensibilités politiques opposées se rencontrent et échangent.
«D’après mon expérience, c’est la possibilité de participation directe qui est hautement valorisée. Elle est associée au caractère d’une longue tradition», explique aussi Michael Strebel. Il précise: «Les assemblées communales disposent de compétences claires. Cela confère à leurs décisions une vraie force contraignante.»
Encore très populaire en Suisse alémanique
«Les électrices et électeurs peuvent donner un retour direct sur la politique locale; l’assemblée communale est perçue comme une possibilité immédiate de participation», observe Michael Strebel, qui ne les fréquente pas seulement en tant que chercheur, mais aussi comme citoyen, dans la capitale cantonale Soleure où il vit.
Au-delà des décisions prises, Philippe Rochat insiste sur la «possibilité de délibération». Contrairement à un vote par bulletin, on peut s’exprimer lors d’une assemblée – pas seulement avec des opinions tranchées, mais aussi avec des doutes. Cela suppose, selon l’expert, une «culture dans laquelle différentes opinions peuvent être exprimées sans conséquences négatives».
L’assemblée communale est surtout répandue en Suisse alémanique. Elle y reste très populaire, la plupart des référendums visant à instaurer un parlement local ayant échoué ces dernières années. À l’inverse, dans les cantons de Genève et Neuchâtel, l’existence d’un parlement local est obligatoire.
Faible participation, mais décisions acceptées
Si ces assemblées restent très appréciées, leur taux de participation est souvent plutôt faible.
Dans certaines grandes communes, la participation à l’assemblée communale n’atteignait que 0,8% des électeurs et électrices il y a dix ans. Mais il montait à presque 45% dans de plus petites localités avec une forte cohésion.

En 2016, le politologue Andreas Ladner (aujourd’hui décédé) estimait à environ 300’000 le nombre de personnes assistant chaque année à une assemblée communale en Suisse. Il n’existe pas de chiffres récents exhaustifs. Michael Strebel a étudié quelques communes: «Le taux de participation ne dépassait pas 10%. Il s’agissait de communes qui débattaient d’un changement de système vers un parlement», explique-t-il. «L’assemblée est perçue comme un lieu de décision politique, de démocratie directe, indépendamment de la participation réelle.»
Cela ne remet pas en cause la légitimité de l’institution ni l’acceptation de ses décisions. Comme le souligneLien externe Philippe Rochat, les assemblées communales aboutissent «généralement à des décisions largement acceptées, malgré une faible participation».
Lisez aussi notre article sur le fédéralisme suisse, qui explique pourquoi la démocratie locale y revêt une telle importance:
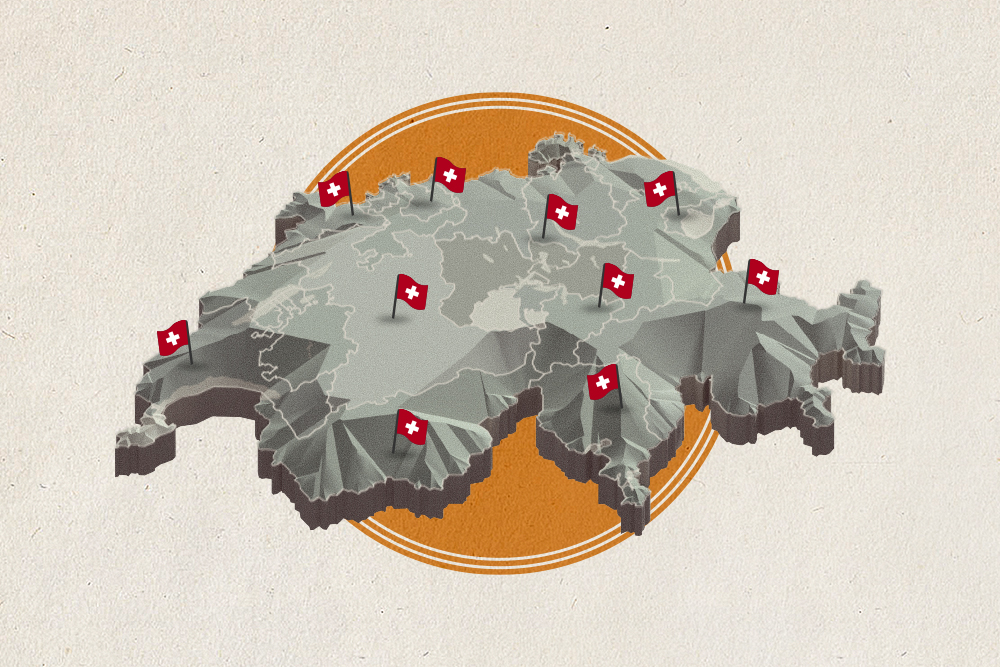
Plus
Le fédéralisme suisse: ses origines et sa perception par la population
Déficit démocratique, naturalisations et terrains de foot
Mais les critiques pointent justement cette faible participation: une minorité déciderait pour l’ensemble. Ils argumentent aussi que l’exécutif local peut facilement s’assurer une majoritéLien externe en sa faveur lors de l’assemblée.
Dans de nombreuses communes, les citoyennes et citoyens votent aussi sur les demandes de naturalisation. Cela provoque régulièrement des remous, des accusations de racisme ou d’arbitraire, notamment lorsque la naturalisation est refusée à des personnes qui tondent leur pelouse le dimanche ou portent des pantalons de joggingLien externe au quotidien.
Les médias s’en font aussi l’écho quand des associations ou groupes d’intérêt exploitent la faible participation pour mobiliser en faveur de leurs objectifs. Il arrive alors que des fonds publics soient distribués dans l’intérêt de quelques-uns – par exemple pour un coûteux terrain de football en gazon synthétique. Michael Strebel qualifie cela de «phénomène bien connu». Il dit avoir lui-même assisté à des cas où «un camp se mobilise fortement pour sa cause et finit par l’emporter». On ignore toutefois la fréquence globale de ce phénomène.
«Pour désamorcer ce type de mobilisation unilatérale, une solution serait de soumettre les décisions de l’assemblée communale à un vote final», propose Michael Strebel. Certaines communes appliquent déjà ce principe: au-delà d’un certain montant de dépenses, un vote populaire est requis.
À l’inverse de ces exemples négatifsLien externe, Philippe Rochat dit avoir observé dans ses recherches une «morale de l’intérêt général», selon laquelle «les personnes présentes, notamment dans les grandes communes, se sentent aussi responsables pour celles qui sont absentes». Les votes ne sont donc pas seulement motivés par l’intérêt personnel, mais aussi par le bien commun.
Comment démocratie directe et démocratie représentative s’articulent-elles dans le système politique suisse? Retrouvez notre analyse approfondie sur le sujet:

Plus
Comment le système de démocratie directe fonctionne en Suisse
Texte relu et vérifié par Marc Leutenegger, traduit de l’allemand à l’aide d’un traducteur automatique/dbu

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative




























Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.