
Les glaciers des Alpes fondent même sur les sommets les plus élevés

Les glaciers suisses ont perdu un quart de leur volume au cours des dix dernières années. L’augmentation des vagues de chaleur et la diminution des chutes de neige en montagne pourraient entraîner la disparition de presque tous les glaciers alpins d’ici la fin du siècle.
Le changement climatique ne laisse aucun répit aux glaciers suisses. En 2025, leur volume a diminué de 3% par rapport à l’année précédente, selon la dernière évaluation du Réseau suisse de surveillance des glaciers (GLAMOS) et de l’Académie suisse des sciences naturelles. Il s’agit du recul le plus important après ceux enregistrés en 2003, 2022 et 2023.
«Cette année s’est révélée un peu moins extrême que ce que nous redoutions», déclare Matthias Huss, directeur de GLAMOS. «Ce qui me frappe et m’inquiète toutefois, c’est que nous sommes en train de nous ‘habituer’ à ces années très négatives. C’est une nouvelle normalité, qui pourtant ne devrait pas exister.»
Les Alpes se réchauffent plus rapidement que la moyenne mondiale et les glaciers suisses ont perdu un quart de leur volume depuis 2015, souligne GLAMOS. Entre 2016 et 2022, une centaine de glaciers – sur un total d’environ 1400 – ont complètement disparu en Suisse.
Les glaciers suisses reculent même en haute altitude
La fonte observée cette année a été favorisée par le manque de neige durant l’hiver dernier. La couche neigeuse qui protège habituellement le glacier de la chaleur estivale s’est révélée insuffisante. Dans certaines régions des Grisons, les niveaux de neige fraîche ont été parmi les plus bas jamais enregistrés, indique GLAMOS.
Les vagues de chaleur de juin – le deuxième mois de juin le plus chaud depuis le début des relevés en 1864 – et d’août ont également contribué au recul des glaciers. «En juin, je suis allé plusieurs fois sur le même glacier: c’est incroyable de constater que l’épaisseur peut diminuer d’un mètre en un peu plus d’une semaine», explique Matthias Huss.
Les glaciers les plus touchés sont ceux situés en dessous de 3000 mètres d’altitude. L’épaisseur des glaciers de la Plaine Morte dans les Alpes bernoises et de la Silvretta dans les Grisons a diminué en moyenne de deux mètres par rapport à 2024. La fonte sur le glacier d’Aletsch, le plus vaste des Alpes, a dépassé les quatre mètres dans certaines zones.
Cependant, même les glaciers les plus en altitude ne sont pas épargnés. Cet été, la limite du zéro degré a dépassé à plusieurs reprises les 5000 mètres d’altitude. «C’est un phénomène nouveau, que nous observons seulement depuis quelques années. La fonte des glaciers concerne aussi les sommets les plus élevés», affirme Matthias Huss. Seul un mois de juillet relativement frais et humide, ajoute-t-il, a permis d’éviter le pire.

Les glaciers se retirent dans tous les pays alpins
Le recul des glaciers ne se limite pas à la Suisse. «Tous les glaciers des Alpes partagent le même destin: un recul frontal et une réduction de leur surface et de leur épaisseur, même sur les versants exposés au nord», affirme Vanda Bonardo, responsable de la Caravane des glaciersLien externe.
Cette campagne itinérante née en Italie a pour objectif de surveiller les glaciers alpins et de sensibiliser aux impacts du changement climatique. Cet été, la Caravane a visité huit glaciers en Italie, en Suisse et en Allemagne.
L’évolution du glacier de l’Adamello, en Lombardie, le plus grand d’Italie, est particulièrement significative, selon elle. «Par rapport à la visite d’il y a deux ans, il a complètement changé: le front s’est effondré et sa longueur a diminué de plusieurs centaines de mètres», décrit Vanda Bonardo.
Au cours des 60 dernières années, les Alpes italiennes ont perdu une surface glacée de plus de 170 km², soit l’équivalent de la superficie du lac de Côme, indique la Caravane dans son dernier bilan.
En raison du réchauffement climatique, le sort des 93 glaciers d’Autriche semble également scellé. «D’ici 40 à 45 ans, toute l’Autriche sera pratiquement dépourvue de glace», déclarait l’an dernier Andreas Kellerer-Pirklbauer, responsable du service national de mesure des glaciers.
La Mer de Glace, le plus grand glacier de France, situé au-dessus de Chamonix, recule en moyenne de 30 mètres par an depuis 2003. Si les températures mondiales continuent d’augmenter selon les trajectoires actuelles, le volume du glacier diminuera de 80% d’ici 2100, prévoit l’Université Grenoble Alpes.
En Allemagne, la principale source d’inquiétude concerne le pergélisol, la couche de sol gelée en permanence. Elle pourrait disparaître complètement d’ici cinquante ans, augmentant l’instabilité des versants montagneux.
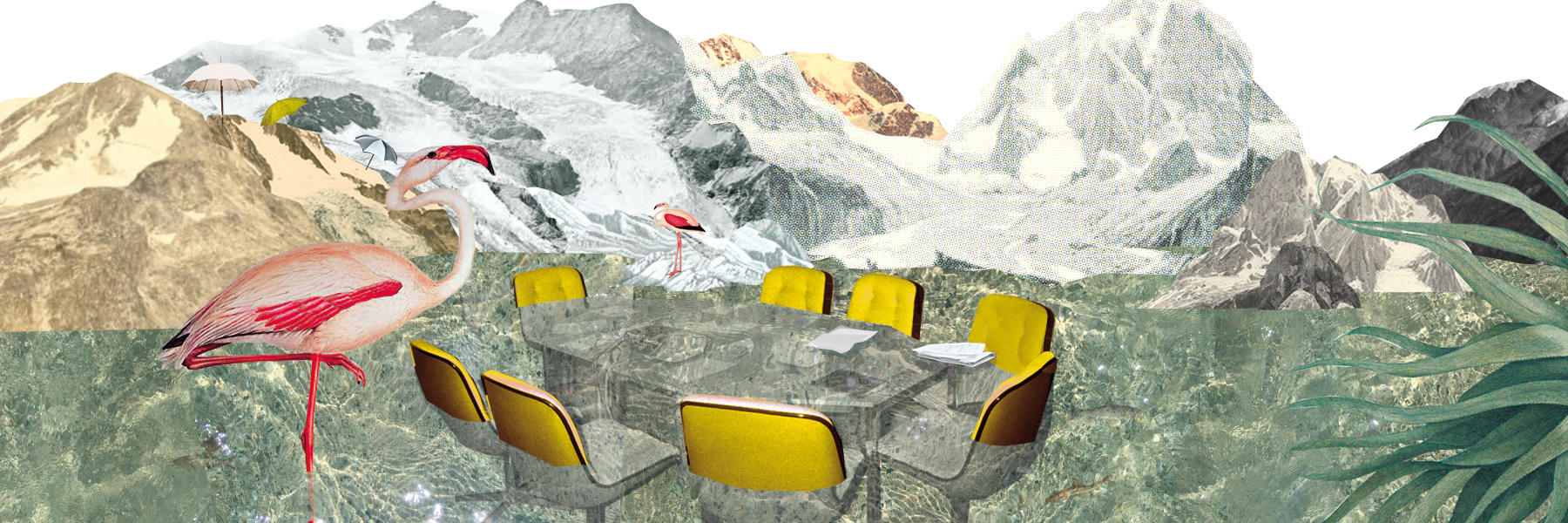
Plus
Pourquoi la fonte des glaciers nous concerne
Des montagnes plus instables
Le recul des glaciers, en plus de transformer profondément le paysage alpin avec des répercussions sur le tourisme, a aussi des conséquences pour le secteur hydroélectrique. À l’avenir, des mesures d’adaptation seront nécessaires, car le flux d’eau alimentant les bassins artificiels en montagne dépendra de plus en plus des précipitations directes et de la fonte de la neige, plutôt que de celle des glaciers.
Ce qui inquiète les spécialistes, ce n’est pas seulement la diminution de la quantité de glace, mais aussi les risques que cela entraîne. «Le recul progressif des glaciers déstabilise la montagne, ce qui peut provoquer des événements comme l’effondrement de parois rocheuses et de masses de glace. C’est ce qui a causé la destruction du village de Blatten», affirme Matthias Huss.
Blatten, un modèle de gestion des dangers naturels
Blatten n’est pas seulement le symbole des effets désastreux que peut provoquer la fonte des glaciers et du pergélisol dans les Alpes. Pour Vanda Bonardo, c’est aussi un modèle en matière de gestion des dangers naturels. A ses yeux, c’est la démonstration que la recherche et le suivi contribuent à réduire les risques.
À Blatten, les technologies d’observation des dangers naturels – comme les caméras et les appareils radar – ont permis aux autorités de mettre la population en sécurité avant l’effondrement du glacier.

Plus
Comment les sentinelles high-tech déjouent la grande peur dans la montagne
La Caravane des glaciers et d’autres organisations, dont Pro Natura en Suisse, demandentLien externe une amélioration du suivi des glaciers en Europe et le développement d’une gouvernance pour la gestion de l’environnement alpin.
Cependant, pour préserver les glaciers, il n’existe qu’une seule solution, affirme Vanda Bonardo: «Nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout le reste n’est qu’un palliatif.»

Plus
Le rôle international clef de la Suisse dans la surveillance des glaciers
Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit de l’italien à l’aide de l’IA/op

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative




























Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.