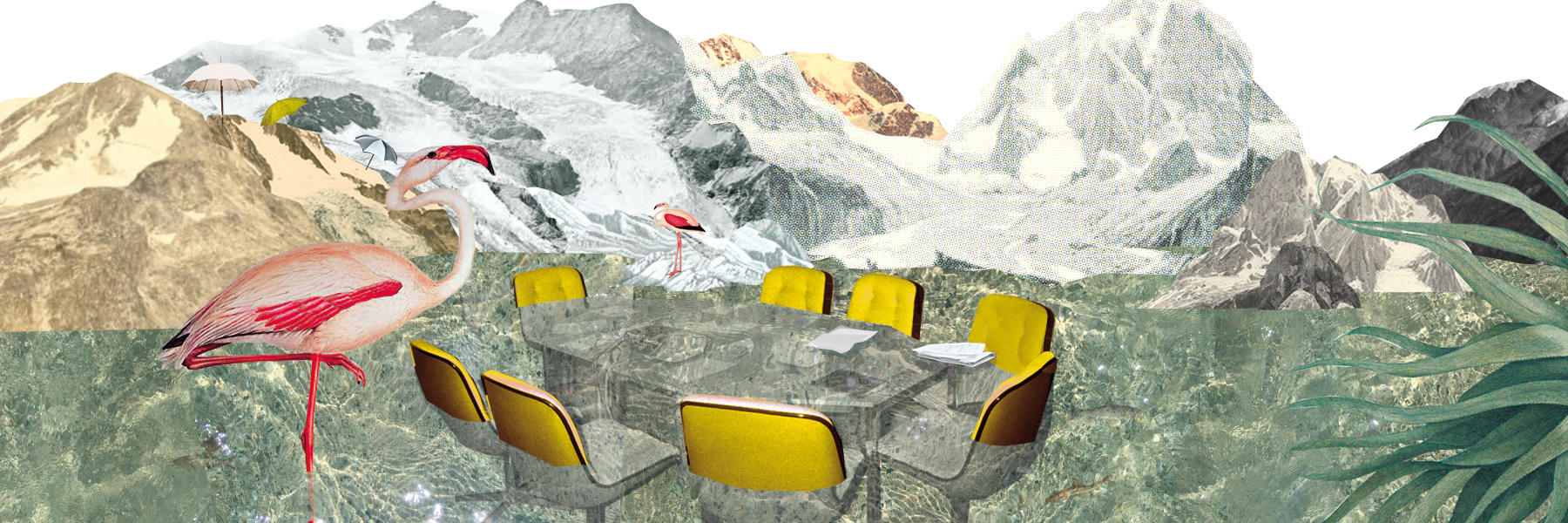La découverte qui bouleversa l’astronomie a 30 ans

Il y a 30 ans, les Suisses Didier Queloz et Michel Mayor ont mis sens dessus dessous le petit monde de l'astronomie. Le 6 octobre 1995, les deux scientifiques ont annoncé la découverte d'une première planète en dehors du système solaire.
(Keystone-ATS) «J’étais complètement abasourdi quand j’ai vu les données», se souvient Didier Queloz, répondant aux questions de l’agence Keystone-ATS. Pour la découverte de cette exoplanète, qui porte le nom de 51 Pegasi b, l’astrophysicien suisse a reçu, avec son aîné Michel Mayor, le prix Nobel de physique, en 2019.
A l’époque Didier Queloz était encore un doctorant à l’Université de Genève (UNIGE) auprès de son professeur Michel Mayor. Pendant des années, les deux chercheurs ont travaillé à la construction d’Elodie, une machine d’un nouveau type, capable de détecter des planètes orbitant autour d’autres étoiles que le Soleil.
«Je n’ai rien dit à Michel»
L’analyse des données initiales a immédiatement révélé quelque chose de complètement inattendu. «Dès les premières observations de l’étoile 51 Pegasi, j’ai remarqué que la vitesse de l’astre changeait régulièrement». Le chercheur a pensé au début que le problème venait de l’instrument de mesure.
«Je n’ai rien dit à Michel, car je voulais d’abord résoudre le problème». Au bout d’un moment, l’astrophysicien doit se rendre à l’évidence. Son outil fonctionne parfaitement et aucune explication technique n’est la cause de ces différences de vitesse observées chez 51 Pegasi.
Le chercheur s’est alors demandé si ce phénomène n’était pas causé par un objet en orbite autour de l’astre. En examinant les données dans le détail, il a trouvé qu’elle pouvait exactement correspondre à une planète qui mettrait quatre jours à tourner autour de son étoile.
«J’ai alors écrit à Michel en lui disant que je pensais avoir trouvé une planète». Le professeur a réagi chaudement. «Plus tard, il m’a cependant avoué qu’il n’avait pas cru un seul mot de ce que je lui avais raconté», se remémore Didier Queloz.
Beaucoup de scepticisme
Mais Didier Queloz avait raison. Michel Mayor n’a pas trouvé d’autres explications aux données d’Elodie. Les mesures ont été refaites, toujours avec le même résultat. La planète existait bel et bien. Les deux chercheurs ont donc soumis un article à la revue spécialisée Nature et ont présenté leur découverte à Florence.
La communauté scientifique s’est tout d’abord montrée sceptique. Personne ne savait s’il existait vraiment des planètes en dehors du système solaire. «Il y avait aussi eu beaucoup de fausses annonces de découvertes d’exoplanètes au cours des années précédentes, d’où la prudence affichée par les spécialistes», note M. Queloz.
De plus, 51 Pegasi b n’aurait jamais dû exister selon les théories admises à l’époque, et pas seulement parce qu’elle est la première exoplanète attestée. L’objet est relativement grand, environ la moitié de la taille de Jupiter, et très proche de son étoile. Selon la théorie, une si grande planète devait être beaucoup plus éloignée.
Des chercheurs américains ont voulu en savoir plus et ont dirigé leur télescope en direction de la constellation de Pégase. Eux aussi sont tombés sur l’exoplanète. Cette confirmation par d’autres équipes de chercheurs a été cruciale pour la reconnaissance définitive de la découverte de 51 Pegasi b.
A la recherche de vie extraterrestre
Pour l’astronomie, 51 Pegasi b représente une révolution. «Depuis, nous ne considérons plus notre système solaire comme isolé», note Didier Queloz. Cette première exoplanète a aussi montré que les planètes peuvent être très différentes de celles qui tournent autour du Soleil. 6000 exoplanètes ont été détectées à ce jour.
Didier Queloz raconte avoir été très surpris de l’intérêt que sa découverte a suscité auprès du grand public. «A l’époque, nous n’avions pas réalisé que lorsque vous parlez d’une planète, les gens commencent immédiatement à rêver d’une vie extraterrestre», souligne l’astrophysicien genevois.
Pourtant, les conditions sur 51 Pegasi b sont loin d’être propices à la vie. Il y règne des températures supérieures à 1000 degrés. Ce qui n’empêche Didier Queloz de croire à une vie extraterrestre. «La question n’est pas de savoir si nous trouverons de la vie», mais comment et quand», indique-t-il.
Aujourd’hui, Didier Queloz, 59 ans, dirige un centre de recherche à l’ETH Zurich qui est spécialisé dans la formation et la propagation de la vie sur la Terre et en dehors de la Terre.
L’Université de Genève va célébrer comme il se doit cette date anniversaire et ses deux chasseurs de planètes en remettant, sa médaille de l’innovation au département d’astronomie lors de son Dies academicus, le 10 octobre.