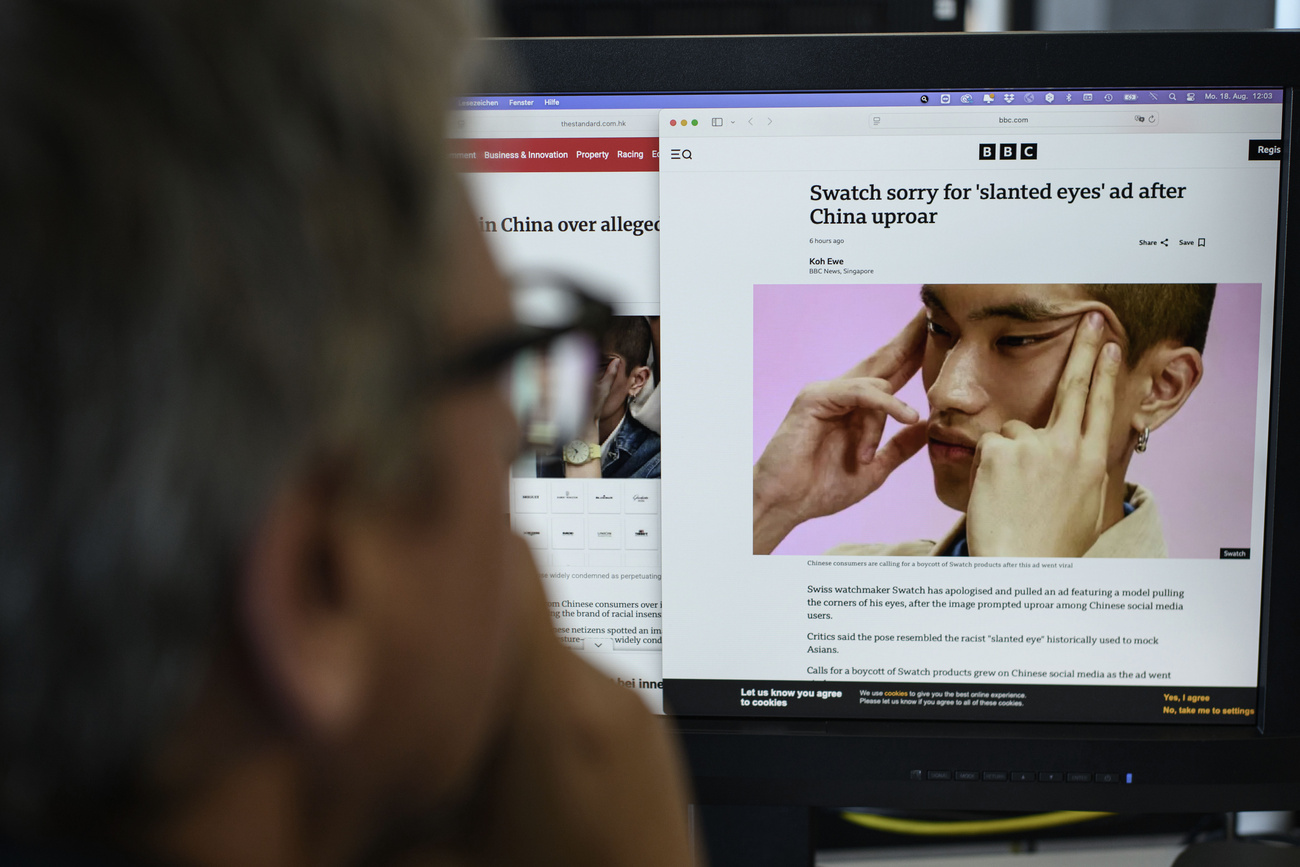La qualité de l’air continue de s’améliorer en Valais

La qualité de l'air en Valais continue de progresser, selon un rapport du canton paru vendredi. Si les niveaux de dioxyde d'azote - issu principalement du trafic routier - et des particules fines sont en diminution, ceux de l'ozone et l'ammoniac restent un défi pour les autorités.
(Keystone-ATS) Globalement, «le bilan est positif et ne tranche pas par rapport aux années précédentes», explique à Keystone-ATS Romain Gaillard, responsable du groupe Air au sein du Service de l’environnement (SEN) valaisan.
C’est grâce au réseau RESIVAL, composé de sept stations, que le SEN monitore la qualité de l’air et entend réduire les émissions à la source. «Grâce à ces efforts, la plupart des valeurs limites sont respectées depuis plus de dix ans», écrit le canton dans un communiqué. Et d’ajouter: «Mais l’augmentation des variations météorologiques complique la prévision et le contrôle de la qualité de l’air.»
Diminution notable
Selon le rapport, les niveaux de dioxyde d’azote continuent de baisser sur tout le territoire. Avec un recul de 54% en un peu plus de dix ans, les seuils respectent les normes légales. A noter que les valeurs observées l’an dernier sont «les plus basses depuis le début des mesures en 1990», observe le canton.
Pour ce qui est des particules fines dites «PM10» – soit ayant un diamètre inférieur à 10 micromètres -, elles ont diminué de 49% depuis 2006, s’établissant ainsi en dessous des limites légales depuis 2014.
Les PM2.5, fractions plus fines des premières et plus nocives, restent elles aussi en dessous du seuil, après un dépassement marqué en 2022 en raison d’incursions importantes de sables du Sahara.
Niveaux élevés de certains gaz
Le véritable défi se trouve du côté de l’ozone, de l’ammoniac et des oxydes d’azote, qui figurent parmi les polluants les plus nocifs pour les écosystèmes et la biodiversité. «Nous sommes dans les niveaux de tolérance maximum», relève Romain Gaillard.
Les plantes qui y sont les plus vulnérables sont les mousses et les lichens, qui restent exposés à des concentrations critiques, notamment en marge de la plaine du Rhône. Une meilleure maîtrise des émissions à la base et un abaissement des niveaux est donc souhaitable, selon le canton. «L’ammoniac est un cas particulier, souligne toutefois le responsable. La plupart des rejets se font de manière naturelle.»
L’ozone, un challenge national
Ainsi, les niveaux d’ozone continuent de dépasser les limitations fixées par la Confédération selon l’Ordonnance sur la protection de l’air (Opair). Depuis 1990, le réseau cantonal valaisan enregistre des «concentrations excessives» de ce polluant secondaire, qui se forme dans l’air à partir de gazs précurseurs à l’aide du rayonnement solaire.
Cette situation n’est toutefois pas spécifique au Valais et représente un défi à l’échelle suisse, souligne Romain Gaillard. Les villes sont les sources les plus importantes des gaz précurseurs de l’ozone, les véhicules ayant un fort impact sur ces émissions. A cette composante s’ajoute celle des conditions météorologiques et notamment du taux d’ensoleillement.
La situation est «assez moyenne» par rapport au reste du pays. En comparaison à Genève par exemple, le Valais a globalement «moins de trafic, mais plus de soleil», résume le responsable.
Compétence cantonale
En Valais, un plan de mesures pour la protection de l’air a été adopté par le Conseil d’Etat en 2009. Ce plan comprend 18 mesures, allant de la sensibilisation au renforcement des normes et contrôles en passant par des incitations financières. Le Canton met également en place des campagnes régulières.
Comme l’évoque Romain Gaillard, il s’agit principalement de «limiter l’impact du trafic routier et celui des chauffages.» Avant de se montrer rassurant: «On essaie toujours de pousser» et «d’influencer ces niveaux vers la négative.»