
Cinq faits étonnants sur les plaques minéralogiques suisses

Elles sont si courantes qu’on ne les remarque plus. Pourtant, les plaques d’identification de nos véhicules peuvent réserver bien des surprises pour un œil averti. Tout spécialement en Suisse, où certaines particularités sont susceptibles d’étonner les touristes de passage.
1. La plaque est personnelle et non liée au véhicule
Dans une grande majorité de pays, les plaques minéralogiques sont liées au véhicule. Concrètement, un numéro de plaque est créé lorsqu’un véhicule est immatriculé pour la première fois, puis reste associé à ce véhicule tout au long de sa carrière routière, indépendamment de la personne qui le possède. Ce numéro est généralement détruit lorsque le véhicule est définitivement retiré de la circulation et ne sera plus jamais attribué. C’est par exemple le cas en France.
La Suisse fait en revanche partie des quelques pays où les plaques ne sont pas liées à un véhicule, mais à son propriétaire. Beaucoup moins répandu, ce système existe notamment aussi au Liechtenstein, en Norvège, en Suède ou encore dans certains États américains comme la Californie ou l’Oregon.
Concrètement, en Suisse, on reçoit un jeu de plaque la première fois que l’on achète un véhicule et on le conserve généralement tout au long de sa vie. Ces plaques sont transférées à chaque fois que l’on change de véhicule. Il est aussi possible d’utiliser un même jeu de plaques interchangeables si l’on possède deux véhicules.
Pour les plus nostalgiques, il est possible de transférer ce numéro à un membre de la famille lorsque l’on renonce à conduire ou de le réserver pour le retrouver lorsque l’on dépose ses plaques durant une période supérieure à un an. En cas de non-utilisation définitive, le numéro est détruit ou peut être réattribué à un nouvel utilisateur; la pratique diverge selon le canton.

En effet, les plaques d’immatriculation sont gérées par les différents cantons. Pour les propriétaires, ce système fédéraliste a une conséquence très pratique: il n’est pas possible de conserver son numéro lorsque l’on déménage dans un autre canton.
2. Les conducteurs peuvent facilement être identifiés
Les plaques minéralogiques suisses standard ont un fond blanc avec des caractères noirs. Il existe aussi des variantes pour des usages plus limités, par exemple un fond noir avec des caractères blancs pour les véhicules de l’armée.

Les plaques standard sont de forme rectangulaire à l’avant et rectangulaire ou carrée à l’arrière. Les caractères sont constitués de deux lettres qui représentent le canton (par exemple BE pour Berne) et d’une série de chiffres servant à l’identification (six au maximum). La plaque arrière présente aussi les écussons de la Suisse (à gauche) et du canton (à droite).
Dans la plupart des pays, les registres d’immatriculation ne sont pas accessibles au grand public, mais réservés à des organismes comme les forces de l’ordre ou les assurances. En Suisse, la pratique est beaucoup plus souple. Les données sont disponibles en ligne et permettent généralement d’obtenir le nom et la commune de résidence du détenteur.

Là aussi, les règles ne sont pas les mêmes en fonction des cantons et de leur interprétation plus ou moins stricte de la Loi fédérale sur la protection des données. Quelques-uns, comme le Tessin, n’autorisent pas le grand public à consulter le répertoire en ligne, tandis que d’autres, comme FribourgLien externe, se montrent très souples. D’autres encore, comme BerneLien externe, adoptent une voie médiane en demandant une inscription en ligne pour consulter le registre et le paiement d’un émolument d’un franc par résultat.
Quoi qu’il en soit, le pratique apparaît dans la plupart des cas très souple. Cependant, en vertu de l’article 89 de la Loi sur la circulation routièreLien externe, il est possible de s’opposer à la communication de ses données en en faisant la demande. Les différents services cantonaux des automobiles proposent un formulaireLien externe en ligne pour le faire.
3. Un petit canton de Suisse orientale a la cote sur les routes
Certaines plaques sont rares sur les routes suisses. Par exemple, celle du canton d’Uri. C’est dommage d’ailleurs, car elles ont tellement de style avec leur tête de taureau noir sur un fond jaune vif.
En revanche, il est beaucoup plus fréquent de croiser un ours noir sur fond blanc avec les lettres AI, signe que le véhicule provient d’Appenzell Rhodes-Intérieures. Pourtant, comme Uri, ce charmant petit canton est très peu peuplé et éloigné des grands centres urbains. Faut-il en conclure que les Appenzellois ont une âme aventureuse qui les pousse plus que d’autres à sillonner les routes du pays?
Pas vraiment: il y a de très fortes chances pour que ce ne soit pas une personne domiciliée à Appenzell qui conduise, mais un touriste. En effet, une grande partie des voitures de location sont immatriculées à Appenzell Rhodes-Intérieures. Deux raisons à cela: le canton propose des taxes de circulation très basses et des procédures administratives simplifiées pour les immatriculations, ce qui attire les sociétés de location.
Ce commerce génère des revenus stables pour ce petit canton. Et le succès est assuré, puisque chaque année, on y compte autant d’immatriculations que d’habitants. Il est à noter qu’il ne s’agit pas du seul canton à procéder de la sorte. C’est également le cas de Schaffhouse, qui compte aussi beaucoup de voitures de location.
4. Les numéros «spéciaux» peuvent rapporter gros
Peut-être vous souvenez-vous de la plaque EWING 1 dans «Dallas», la célèbre série américaine des années 1980? Ce genre de fantaisie aurait aussi pu se réaliser en Suisse. Dans les cantons les plus peuplés, le système d’immatriculation à six chiffres arrive bientôt en bout de course, d’où l’idée de permettre la création de plaques personnalisées combinant des chiffres et des lettres.
Mais ce n’est pas demain la veille que l’on pourra voir une plaque «SWISSINFO 007». À la fin de l’année dernière, l’Office fédéral des routes a indiqué renoncer à cette idée, car la refonte totale du système serait trop onéreuse, surtout à un moment où l’État économise. Pour résoudre le problème, l’OFROU mise sur le passage à un système d’immatriculation à 7 chiffres, qui pourrait devenir réalité dans le canton de Zurich dès 2027.
Cette décision a déçu certains cantons – en particulier le Tessin – qui pensaient pouvoir générer de substantiels revenus avec des plaques personnalisables. Mais heureusement pour les finances cantonales, le système actuel leur permet déjà de mettre un peu de beurre dans les épinards.
La plupart des services des automobiles permettent de choisir parmi les numéros non encore attribués contre paiement. Et solution plus rentable encore, certains numéros dits «spéciaux» – par exemple à un seul chiffre ou avec des chiffres identiques – sont régulièrement mis aux enchères.

Pour l’heure, le record absolu concerne la plaque ZH 24 (Zurich) qui a été vendue aux enchères pour la somme de 299’000 francs le 3 juillet 2024, dans le cadre d’une vente organisée à l’occasion de l’Euro 2024. Le précédent record concernait la plaque ZG 10 (Zoug), vendue en 2018 pour 233’000 francs. En Suisse romande, le record est de 160’100 francs pour VS 1 (Valais) et au Tessin pour TI 10 vendue pour 135’000 francs.
5. Les plaques suisses ne sont pas à la hauteur en matière de sécurité
Qu’il s’agisse de coffres-forts, de billets de banque, de passeports ou de stockage de donnée, la Suisse jouit d’une solide réputation en matière de sécurité. Mais les plaques minéralogiques viennent jeter une ombre au tableau.
Inchangées depuis 1971, elles ne répondent plus aux normes de sécurité actuelles et sont facilement falsifiables. On peut en commander de fausses à l’étranger en passant par Internet. «En matière de sécurité, nous sommes à la préhistoire», a dénoncé dans la presse André Seiler, patron de Plaques Suisses, l’entreprise leader du marché qui fabrique les plaques de vingt cantons.
Cette problématique a trouvé un relais au niveau politique avec le conseiller aux États Werner Salzmann qui a récemment interpelléLien externe le gouvernement. Dans la réponse, le Conseil fédéral indique que 20 cas de falsification ont été découverts depuis 2024, mais qu’il n’existe pas de statistiques nationales sur le sujet. Lors de la dernière session parlementaire, devant la Chambre haute, le ministre des Transports Albert Rösti a relativisé le problème, indiquant qu’il n’existe pas de risque majeur pour la sécurité de l’État.
Assez peu satisfait de la réponse, Werner Salzmann a déposéLien externe un postulat demandant au Conseil fédéral d’étudier la question plus en détail.
Plus
Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg

En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative










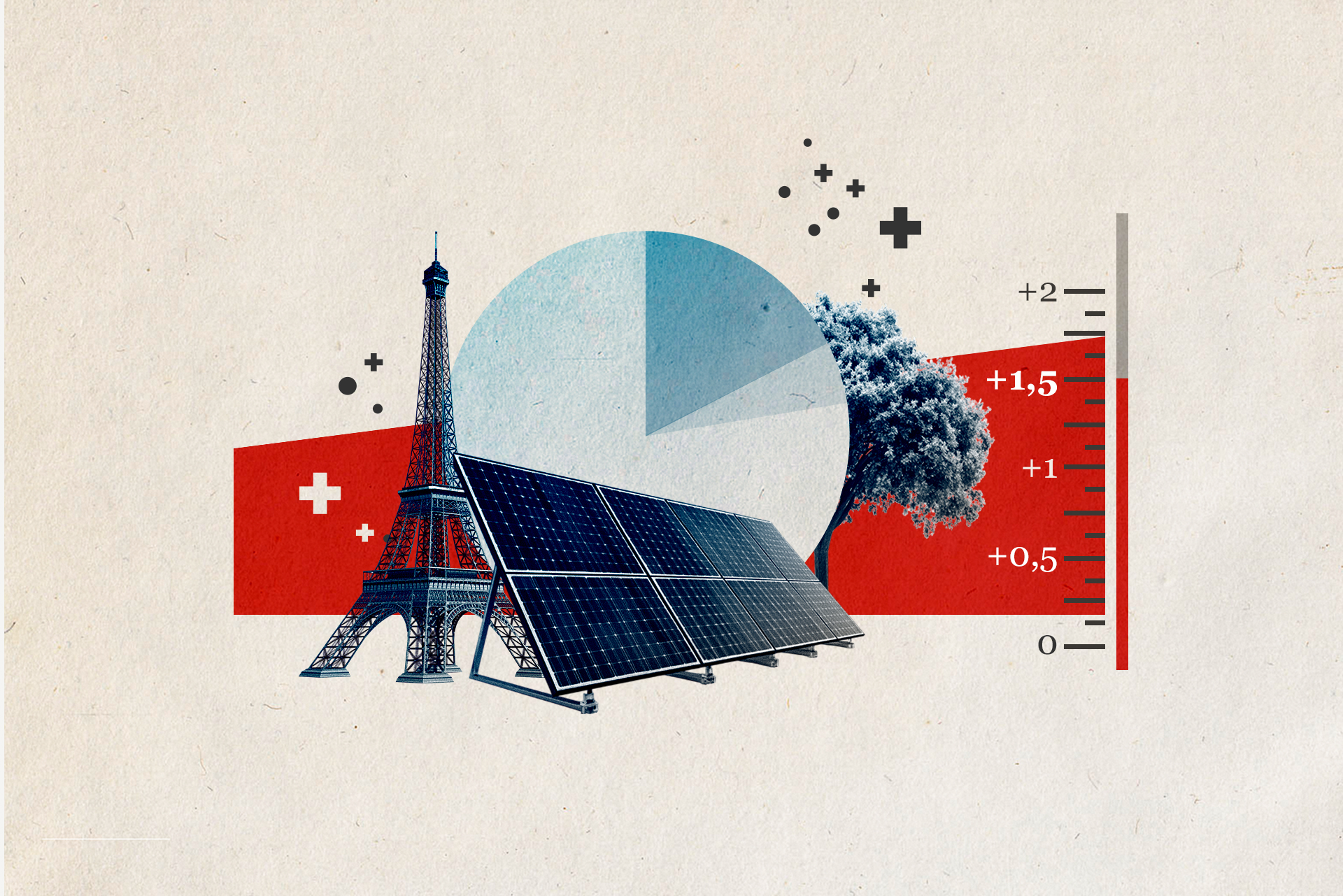
















Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.